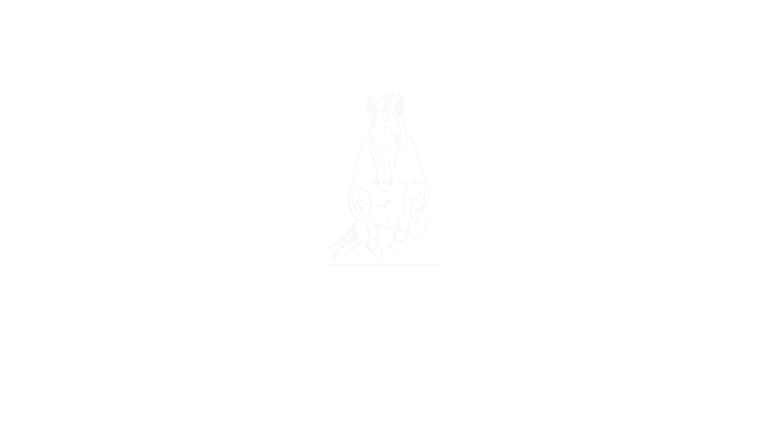Faut-il (vraiment) une IA pour chaque service ? Stratégie tech versus effet de mode
L’IA peut être un levier de transformation puissant, mais mal utilisée, elle peut aussi devenir un gouffre d’énergie, de budget… et de désillusions. Avant de généraliser son usage à tous les services, il est indispensable de faire un pas de côté, de sortir du bruit ambiant, et de se poser la bonne question : où l’IA peut-elle réellement apporter une valeur ajoutée, dans mon entreprise, à court et moyen terme ?
IAMANAGEMENTTECHNOLOGIESTRATÉGIE
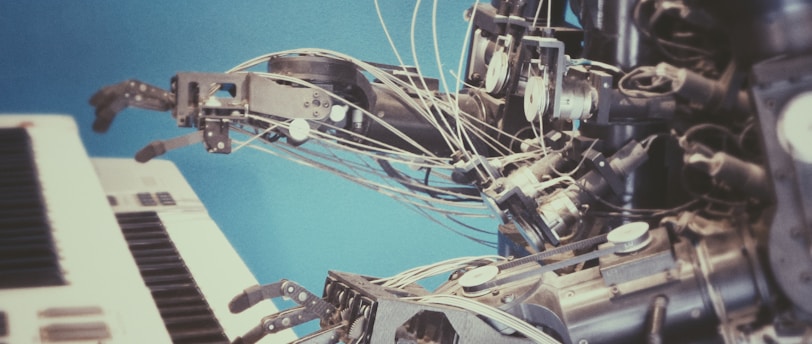

L’enthousiasme généralisé autour de l’intelligence artificielle (IA), notamment depuis l’émergence de solutions comme ChatGPT, pousse de nombreuses entreprises à envisager son déploiement dans tous les recoins de leur organisation. En quelques mois, l’IA est devenue omniprésente dans les discours, les promesses technologiques et même les comités de direction. Dans ce contexte effervescent, une question essentielle se pose aux dirigeants de PME et ETI : faut-il vraiment intégrer une IA dans chaque service, ou assiste-t-on simplement à une nouvelle vague de mimétisme technologique ?
La tentation est forte. Beaucoup d’entreprises redoutent de « rater le virage » ou de se faire distancer par leurs concurrents, ce qui alimente une dynamique où l’IA est perçue comme incontournable. Pourtant, si l’on quitte le terrain du discours pour regarder les usages réels, le contraste est frappant. En 2023, moins de 5 % des PME françaises utilisaient effectivement des outils d’IA dans leurs processus internes. Cela montre que, malgré la pression ambiante et l’omniprésence médiatique du sujet, l’adoption concrète reste encore très marginale et souvent expérimentale.
Ce décalage traduit une forme d’hésitation bien compréhensible : d’un côté, l’engouement suscité par les promesses de performance, de gain de temps et d’automatisation ; de l’autre, la prudence nécessaire face à des investissements coûteux, des compétences rares, et des retours sur investissement parfois incertains.
L’année 2025 semble pourtant marquer un tournant : plusieurs baromètres récents placent désormais l’IA en tête des priorités stratégiques des dirigeants à l’échelle mondiale. Le sujet n’est plus cantonné aux directions innovation ou IT, il s’invite dans les arbitrages de gouvernance. Beaucoup de chefs d’entreprise sont convaincus qu’il s’agit d’une transformation majeure, comparable à l’arrivée d’internet ou du smartphone.
Mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Depuis plusieurs mois, des experts alertent sur une tendance préoccupante : celle des entreprises qui se lancent dans des projets IA sans réel cadrage, parfois uniquement pour « suivre le mouvement » ou donner des gages de modernité à leur écosystème. Or, comme toute technologie, l’IA ne crée de valeur que si elle répond à un besoin précis, bien défini, et intégré dans une stratégie globale.
Autrement dit : l’IA peut être un levier de transformation puissant, mais mal utilisée, elle peut aussi devenir un gouffre d’énergie, de budget… et de désillusions. Avant de généraliser son usage à tous les services, il est donc indispensable de faire un pas de côté, de sortir du bruit ambiant, et de se poser la bonne question : où l’IA peut-elle réellement apporter une valeur ajoutée, dans mon entreprise, à court et moyen terme ?
Tendances actuelles : entre effet de mode et pression concurrentielle
La montée en puissance de l’intelligence artificielle, en particulier sous sa forme générative, a déclenché une vague de mimétisme dans le monde de l’entreprise. Beaucoup de dirigeants ne se demandent plus si l’IA peut résoudre un problème précis dans leur organisation, mais s’interrogent plutôt sur ce qu’ils risquent à ne pas en adopter. Depuis l’arrivée de ChatGPT, on observe une inflation soudaine de “spécialistes” autoproclamés de l’IA et une injonction tacite à suivre la tendance, sous peine de passer pour une entreprise dépassée.
Ce phénomène tient en grande partie à ce qu’on appelle le syndrome du FOMO — Fear of Missing Out, ou la peur de rater une opportunité. Il pousse de nombreuses PME et ETI à envisager des projets IA avant même d’avoir défini un besoin clair ou évalué leur capacité réelle à les mettre en œuvre. À l’opposé, un autre réflexe s’installe en parallèle : le FOMU (Fear of Messing Up), ou la peur de faire un mauvais choix technologique, d’investir à perte, voire de se ridiculiser avec un projet mal calibré. Ces deux postures, bien que contradictoires, coexistent souvent chez les mêmes décideurs : enthousiasme affiché à l’extérieur, mais prudence extrême en interne.
À cela s’ajoute une pression croissante de l’écosystème. Certains clients stratégiques ou donneurs d’ordre encouragent (directement ou non) leurs partenaires à s’aligner sur des pratiques technologiques modernes, IA incluse. Voir un concurrent communiquer sur ses avancées en la matière peut déclencher un sentiment d’urgence — ou du moins, une obligation d’exploration, ne serait-ce que pour ne pas donner l’impression de prendre du retard.
Le discours ambiant est également nourri par les grandes entreprises et éditeurs de logiciels, qui promettent des gains de productivité spectaculaires. L’IA devient alors, dans l’imaginaire collectif, un passage obligé. Certains leaders de marché affichent effectivement des résultats probants, contribuant à renforcer la croyance qu’adopter l’IA, c’est nécessairement prendre une longueur d’avance. Cette dynamique alimente une course à l’innovation qui repose parfois davantage sur la communication que sur des projets ancrés dans la réalité opérationnelle.
Pour autant, il est essentiel de garder à l’esprit que le niveau de maturité varie fortement d’une entreprise à l’autre. Sur le terrain, la majorité des PME reste prudente, voire attentiste. Les études les plus récentes montrent qu’en France, à peine une entreprise sur vingt utilise aujourd’hui des outils d’IA de manière effective. En d’autres termes, le sujet est omniprésent dans les discours, mais encore largement absent des pratiques courantes. Ce décalage révèle une tension bien réelle entre l’envie d’innover et la nécessité de sécuriser ses choix stratégiques.
Finalement, l’IA est à la fois un puissant levier de transformation et une tendance technologique que beaucoup suivent sans réelle conviction, parfois à contre-emploi. Il est donc essentiel, pour toute entreprise, de faire le tri entre ce qui relève du buzz… et ce qui peut réellement générer de la valeur. Et cela commence par une analyse lucide des besoins et des priorités internes, service par service.
Tour d’horizon des usages de l’IA par fonction
Plutôt que de croire à une IA universelle applicable partout sans distinction, il est plus pertinent d’observer ce que l’IA peut concrètement apporter à chaque grande fonction de l’entreprise. Car si certaines activités peuvent être fortement optimisées, d’autres relèvent encore largement du bon sens humain, de la relation, ou de la stratégie fine.
Ressources humaines (RH)
L’IA est d’abord utilisée en RH pour automatiser des tâches chronophages, notamment dans le recrutement. Des solutions sont capables d’analyser des centaines de CV, de les trier selon des compétences ciblées, voire d’évaluer des entretiens vidéo en repérant certains traits comportementaux. Cela permet de réduire le temps de traitement des candidatures et d’accélérer les recrutements, tout en élargissant le champ de recherche.
Au-delà du recrutement, l’IA est utilisée pour personnaliser les parcours de formation, anticiper les besoins en compétences, ou encore produire des contenus internes adaptés au ton et au profil des salariés. Certaines grandes entreprises ont même déployé des plateformes IA capables de faire correspondre automatiquement projets et collaborateurs en fonction de leurs compétences et aspirations.
Bénéfices : gain de temps, meilleure objectivité, standardisation des process, formation plus efficace.
Limites : les biais algorithmiques peuvent reproduire des discriminations préexistantes. Les collaborateurs peuvent aussi percevoir une perte d’humanité, surtout si l’IA est utilisée pour évaluer les performances ou suggérer des évolutions de carrière. Enfin, les PME disposent souvent de peu de données RH exploitables pour entraîner efficacement ces outils.
Finance et gestion administrative
Dans ces fonctions, l’IA est surtout mobilisée pour automatiser des traitements lourds et améliorer la précision. C’est le cas, par exemple, de la lecture automatisée de factures ou de notes de frais, qui permet une intégration directe dans les systèmes comptables. L’IA peut aussi repérer des anomalies dans les flux financiers ou dans les comportements d’achat, contribuant à la prévention des fraudes.
Certaines IA génératives permettent même de produire automatiquement des rapports financiers, des synthèses de documents ou des présentations pour les comités de direction.
Bénéfices : gain de temps, réduction des erreurs, renforcement des contrôles, amélioration de la réactivité dans les prises de décision.
Limites : acceptation parfois difficile par les équipes (peur de l’obsolescence de certains postes), besoin de données fiables et historiques, questions de sécurité et de confidentialité (particulièrement pour les données comptables et fiscales).
Marketing et commercial
Les fonctions commerciales et marketing sont sans doute celles où l’IA a connu l’adoption la plus rapide. Elle permet, en analysant le comportement des clients, de segmenter finement les publics, de personnaliser les recommandations, de prévoir les risques de désengagement ou les opportunités de vente croisée.
Côté relation client, les chatbots ou assistants vocaux répondent aux demandes simples, orientent les clients ou prennent en charge certains processus (suivi de commande, prises de rendez-vous...). On voit aussi apparaître des IA capables de générer automatiquement les descriptifs de fiches produits, ou d’analyser les réseaux sociaux pour ajuster l’offre.
Bénéfices : expérience client enrichie, personnalisation, meilleure efficacité commerciale, gain de temps pour les équipes.
Limites : risque de déshumanisation de la relation client, rejet par une partie des utilisateurs, questions éthiques sur l’analyse comportementale, dépendance à des données personnelles (RGPD), et nécessité de garder le bon dosage entre humain et automatisation.
Production et opérations
Dans les activités de production, l’IA est exploitée pour la maintenance prédictive (anticiper les pannes à partir des données capteurs), le contrôle qualité automatisé (vision industrielle), ou encore l’optimisation de la chaîne logistique (prévision de la demande, gestion des stocks, optimisation des tournées).
Les robots intelligents, capables d’adapter leurs mouvements ou cadences en fonction des conditions, gagnent aussi du terrain. L’IA facilite également le suivi des flux, l’automatisation d’entrepôts ou le calcul d’itinéraires logistiques intelligents.
Bénéfices : productivité accrue, coûts réduits, flexibilité, réduction des arrêts de production, amélioration des conditions de travail.
Limites : investissements lourds, difficultés d’intégration technique (systèmes hétérogènes), risque social si la transformation n’est pas accompagnée, vulnérabilités cyber et complexité de supervision.
Fonctions juridiques
L’IA fait progressivement son entrée dans les directions juridiques et les cabinets. Les cas d’usage les plus avancés concernent l’analyse de contrats, la revue documentaire et la recherche juridique assistée. Les outils peuvent extraire les clauses clés d’un contrat, repérer des risques, ou proposer des synthèses à destination des non-juristes.
D’autres solutions permettent de classer automatiquement les documents, d’indexer les dossiers, voire de traduire des textes juridiques dans plusieurs langues.
Bénéfices : gain de temps, amélioration de la conformité, réduction du risque d’oubli, accès plus rapide à l’information.
Limites : risques d’erreur d’interprétation, responsabilité juridique non déléguable, sensibilité extrême des données traitées (confidentialité, secret professionnel), besoin de validation humaine systématique.
Ce panorama montre que l’IA peut apporter une valeur ajoutée significative dans de nombreux domaines, à condition d’avoir une approche ciblée, mesurée, et alignée sur les enjeux spécifiques de chaque service.
Les risques d’un déploiement non stratégique de l’IA
Si les cas d’usage précédents illustrent un véritable potentiel, ils rappellent aussi une règle fondamentale : intégrer de l’intelligence artificielle sans une vision claire peut s’avérer contre-productif, voire préjudiciable. Plusieurs entreprises se sont lancées dans des projets IA sous l’effet de mode, sans véritable réflexion stratégique, et ont connu des échecs coûteux. Il est donc essentiel d’identifier les principaux risques d’un déploiement mal calibré.
Coûts cachés et retour sur investissement incertain
L’IA nécessite des investissements souvent importants : logiciels, infrastructures, accompagnement technique, formation des équipes… Et tous les projets ne génèrent pas de gains immédiats. Lorsqu’un projet est mal ciblé, il peut s’enliser dans une série de tests sans suite, consommant temps et budget sans livrables concrets. De nombreuses entreprises admettent, avec du recul, que certaines problématiques auraient pu être traitées plus efficacement avec des méthodes plus simples. Une majorité des projets IA qui échouent partagent un point commun : des objectifs mal définis et un retour sur investissement jamais mesuré.
Les PME sont particulièrement exposées à ce risque. À vouloir imiter les grandes entreprises, elles s’aventurent parfois dans des projets trop complexes, mal adaptés à leurs moyens ou à leur maturité. Il vaut souvent mieux initier un projet modeste, mais bien cadré, avec des résultats tangibles, qu’un chantier technologique trop ambitieux.
Dérive technologique : l’illusion de la solution miracle
L’un des dangers fréquents réside dans ce que certains appellent le syndrome de « l’objet brillant » : l’IA fascine, au point que l’on cherche à l’appliquer coûte que coûte, même quand le besoin ne s’y prête pas. Or, tous les problèmes d’entreprise ne nécessitent pas une solution IA. Déployer un chatbot pour « faire moderne » alors que le vrai besoin est humain – par exemple recréer du lien avec les clients – peut aboutir à un échec.
Un projet IA mal aligné sur un objectif métier clair devient vite une solution en quête de problème. Cela peut conduire à négliger des approches plus simples, plus adaptées, comme l’amélioration des processus existants. Un principe souvent rappelé en transformation numérique : il ne faut jamais automatiser un processus défaillant, mais commencer par le structurer. L’IA, dans ce contexte, risque d’amplifier les incohérences au lieu de les corriger.
Déficit de données ou de compétences
L’IA repose sur la donnée. Sans données fiables, structurées et suffisantes, aucun modèle ne peut produire de résultats pertinents. Or, de nombreuses PME découvrent trop tard qu’elles ne disposent pas de l’historique ou de la qualité de données nécessaires. En parallèle, ces projets exigent des compétences spécifiques (data science, ingénierie des données, pilotage de projets IA) qui sont rares, souvent chères, et pas toujours disponibles en interne.
Ce manque peut entraîner une dépendance excessive à des prestataires externes, sans garantie de transfert de compétence ni de maîtrise sur le long terme. Et si les bases ne sont pas solides, un projet IA peut rapidement se transformer en boîte noire non contrôlable, ni maintenable. Enfin, dans un marché en constante évolution, il est crucial d’anticiper les besoins de mise à jour, de supervision et de gouvernance des outils déployés.
Risques cyber et perte de maîtrise
Brancher un système d’IA sur des données sensibles – clients, stratégie, R&D – sans contrôle strict peut générer des vulnérabilités sérieuses. Des erreurs humaines ou des usages non encadrés peuvent exposer l’entreprise à des fuites de données ou à des usages non conformes. On a vu des cas où des salariés ont involontairement transmis des informations confidentielles à des outils IA publics, croyant bien faire.
Au-delà du risque de fuite, l’un des dangers majeurs est la perte de maîtrise. Si l’on ne comprend plus comment l’IA prend ses décisions – notamment dans le cas de modèles dits « boîtes noires » – cela pose des problèmes éthiques, techniques et juridiques majeurs. Dans certains secteurs, cela devient même inacceptable. Enfin, il faut anticiper l’obsolescence rapide des technologies IA : ce qui est à la pointe aujourd’hui peut devenir obsolète en quelques mois. S’enfermer trop vite dans une solution rigide ou propriétaire peut limiter les possibilités d’évolution à moyen terme.
En résumé, un déploiement d’IA mal préparé peut coûter cher, générer de la frustration et affaiblir l’entreprise au lieu de la renforcer. Cela ne signifie pas qu’il faut renoncer à l’IA, bien au contraire. Mais elle doit être intégrée de manière raisonnée, alignée sur des objectifs concrets, et pilotée avec méthode. Une IA bien pensée peut être un formidable levier de transformation. Une IA précipitée, elle, reste un risque stratégique majeur.
Comment évaluer si un service a vraiment besoin d’IA ?
Avant de lancer un projet IA dans un service donné, il est essentiel de se poser les bonnes questions. Voici cinq critères clés pour aider les dirigeants de PME et ETI à déterminer si un besoin d’IA est réel, pertinent et stratégiquement justifié.
Maturité des processus existants
Le service dispose-t-il de processus bien définis, fiabilisés, et si possible numérisés ? L’IA s’appuie sur des bases solides. Si les activités sont encore réalisées de façon artisanale ou sans cadre formel, mieux vaut commencer par structurer les processus via des approches classiques (digitalisation, lean management) avant de les enrichir par de l’IA. Par exemple, inutile d’implanter un outil de prédiction sur la production si aucune donnée fiable n’est encore collectée. L’IA n’est efficace que sur un terrain préparé.
Qualité et disponibilité des données
Pas d’IA sans données. Il faut inventorier les sources internes et évaluer si elles sont exploitables : volume suffisant, fraîcheur, homogénéité, fiabilité. Un modèle IA construit sur des données partielles ou bruitées risque de produire des résultats peu exploitables. Si les données sont inexistantes ou de qualité insuffisante, il faudra soit d’abord les collecter (via des capteurs, une base de connaissances, etc.), soit opter pour une solution plus simple. Dans certains cas, la mutualisation sectorielle des données peut être une piste, en s’appuyant sur des partenaires ou des dispositifs collectifs.
Retour sur investissement et valeur attendue
Quelle est la valeur ajoutée attendue du projet ? L’IA doit permettre de gagner du temps, de l’argent, de la qualité ou de la satisfaction client. Il est nécessaire d’estimer ces bénéfices, de les chiffrer, et de les comparer au coût du projet (achat de solution, intégration, maintenance). Un bon projet IA montre un ROI réaliste à 12-24 mois. Si les gains sont flous ou mineurs, mieux vaut chercher une autre priorité. À noter : les coûts récurrents (abonnements, mises à jour) doivent être inclus dans le calcul.
Complexité du problème à résoudre
L’IA est pertinente pour les problèmes complexes, répétitifs ou de grande échelle, où l’analyse humaine montre ses limites. Il faut se demander si la situation justifie un recours à des modèles avancés (machine learning, deep learning), ou si une solution basique résoudrait déjà 80 % du besoin. Par exemple, si les méthodes statistiques classiques suffisent pour prévoir la demande, inutile d’entraîner un réseau de neurones. L’IA doit répondre à un vrai besoin de précision ou d’efficacité, pas simplement être un outil impressionnant.
Adhésion et capacités organisationnelles
Le projet bénéficie-t-il d’un soutien clair en interne ? Les équipes concernées sont-elles prêtes à utiliser l’outil, à s’adapter, à se former ? Une IA qui n’est pas comprise ou acceptée reste sans effet. Il faut identifier un sponsor, des utilisateurs-clés, prévoir un accompagnement au changement. De même, l’entreprise doit pouvoir piloter l’outil sur la durée, même avec l’aide d’un prestataire : suivi de performance, budget de maintenance, évolution des modèles, etc.
Conclusion : vers une adoption alignée avec la stratégie d’entreprise
Faut-il une IA pour chaque service ? La réponse est nuancée. L’IA n’est pas un objectif en soi, mais un outil au service d’une ambition stratégique. Les dirigeants de PME et ETI ont tout intérêt à explorer son potentiel, mais avec discernement.
Il s’agit d’abord d’aligner l’IA sur la vision globale : chaque projet doit répondre à une priorité claire, qu’il s’agisse de mieux servir les clients, d’améliorer la performance, ou de libérer du temps pour les équipes. Ensuite, adopter une approche par étapes : tester des cas d’usage limités, mesurer les résultats, ajuster, puis étendre. La transformation doit être progressive et adaptée.
L’implication des métiers est déterminante. Les utilisateurs finaux doivent être associés dès le début, pour garantir la pertinence des solutions et faciliter leur appropriation. Une communication claire, honnête et pédagogique est indispensable pour accompagner le changement.
Enfin, la gouvernance doit être structurée : définir qui pilote, qui valide, comment sont gérés les risques, les données, la conformité éthique et réglementaire. L’IA engage l’image de l’entreprise et sa responsabilité ; elle doit être encadrée en conséquence.
En somme, chaque service peut avoir une IA utile, mais pas nécessairement. Ce qui compte, c’est de déployer les bons outils, au bon endroit, pour les bonnes raisons. L’IA n’est ni une mode à suivre aveuglément, ni un luxe réservé aux grandes entreprises : c’est un levier de performance à activer avec lucidité, ambition et pragmatisme. Pour les PME et ETI, c’est une opportunité à saisir intelligemment, en restant maîtres de leur stratégie.
Pour prendre rendez-vous avec un des experts chez Chapman & Chapman, cliquez ici.
Chapman & Chapman SAS
Stratégie et juridique pour vos projets d'affaires.
© 2025. All rights reserved.
SIRET 94269043900016