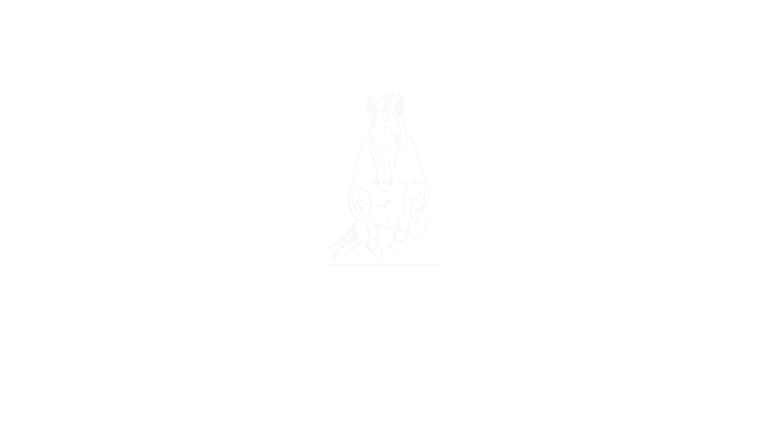IA : comment elle va transformer le travail et comment s’y préparer - partie 1
« Personne n’est prêt ». C’est en ces termes que l’ex-PDG de Google, Eric Schmidt, a récemment mis en garde sur l’onde de choc imminente de l’intelligence artificielle (IA) dans le monde du travail.
MANAGEMENTIACARRIÈREDÉVELOPPEMENT PERSONNELTECHNOLOGIE


« Personne n’est prêt ». C’est en ces termes que l’ex-PDG de Google, Eric Schmidt, a récemment mis en garde sur l’onde de choc imminente de l’intelligence artificielle (IA) dans le monde du travail. De l’avis de ce pionnier de la tech, les entreprises et les travailleurs sous-estiment l’ampleur et la rapidité des changements à venir. Effectivement, l’IA – et en particulier l’IA générative comme ChatGPT – s’invite déjà dans nos bureaux, usines et organisations à un rythme effréné. Cet article, inspiré par l’analyse des Échos citant Eric Schmidt, dresse un panorama complet de l’impact de l’IA sur le travail en Europe et propose des conseils concrets pour s’y adapter.
L’objectif : fournir un dossier de référence, accessible et professionnel, utile aux managers, dirigeants, et professionnels en transition qui s’interrogent sur l’ère de l’IA.
Ce qui va changer : une révolution accélérée par l’IA
L’IA promet de transformer en profondeur nos façons de travailler dans les années à venir. Qu’est-ce qui va changer ? Presque tout, ou du moins une partie significative de nos tâches quotidiennes. Selon le Forum Économique Mondial, 22 % des emplois actuels subiront des transformations majeures d’ici 2030. En moyenne, un tiers du temps de travail pourrait être « exposé » à l’IA en France, signe que rares seront les métiers totalement épargnés. Concrètement, l’IA va accélérer l’automatisation de nombreuses tâches répétitives, administratives ou analytiques. Des outils dopés à l’IA sont déjà capables de rédiger des textes, de résumer des documents, de générer du code informatique ou d’analyser des images en quelques secondes – des tâches qui prenaient autrefois des heures de travail humain.
Cette automatisation ne se limite pas aux usines : elle touche aussi les métiers du tertiaire. Par exemple, dans la finance, l’IA peut traiter des opérations comptables de base, dans le droit elle peut effectuer de la recherche jurisprudentielle, et dans le marketing elle peut personnaliser des campagnes entières. Les modèles de langage (de type GPT) et autres systèmes intelligents vont s’intégrer dans la quasi-totalité des logiciels professionnels, rendant de nombreux processus plus rapides et plus efficaces. « Les systèmes d’IA seront de plus en plus répandus et les possibilités d’application de plus en plus nombreuses », anticipe une enquête européenne (68 % des salariés partagent cet avis). En parallèle, les décisions pilotées par la donnée (data-driven) vont s’intensifier : l’IA permettra d’analyser des volumes massifs de données pour éclairer la stratégie, la gestion des clients ou l’optimisation des opérations.
Au-delà des tâches, les emplois eux-mêmes évolueront. Certains postes vont apparaître (spécialiste en IA, prompt engineer, éthicien de l’IA, etc.), tandis que d’autres verront leur périmètre changer. D’après une récente étude de Roland Berger, environ 800 000 emplois pourraient être automatisés par l’IA générative en France, mais 1,4 million d’autres bénéficieraient de gains de productivité significatifs. Autrement dit, l’IA aura un double effet : effet de substitution pour certaines fonctions, et effet d’augmentation pour beaucoup d’autres. Lorsqu’une tâche répétitive est confiée à l’IA, le professionnel peut consacrer ce temps gagné à des activités à plus forte valeur ajoutée. Ainsi, plutôt que de supprimer purement et simplement le travail humain, l’IA va souvent redéfinir les rôles : l’humain travaillera en tandem avec la machine, se focalisant sur la supervision, l’interprétation des résultats, la créativité ou la relation client, pendant que l’IA gèrera le travail routinier.
Enfin, la vitesse du changement est un facteur clé. Ce qui va changer, ce n’est pas seulement quoi mais aussi quand. Et cela pourrait être beaucoup plus rapide que prévu. Eric Schmidt estime que l’IA atteindra un niveau encore supérieur d’ici seulement deux ans. En d’autres termes, la révolution n’est pas pour un futur lointain – elle est déjà en marche, et s’accélère. Les entreprises qui s’adaptent vite pourront en tirer parti, tandis que les autres risquent de subir un choc.
Ce qui a déjà changé : l’IA au travail, une réalité d’aujourd’hui
Si l’on parle autant de l’IA aujourd’hui, c’est qu’elle a déjà commencé à changer le travail de millions de personnes. En Europe, près des trois quarts des salariés (73 %) ont déjà eu une expérience pratique de l’IA dans leur vie professionnelle ou personnelle. L’outil qui a servi de déclic est sans conteste ChatGPT, dévoilé fin 2022, qui a fait découvrir au grand public comme aux professionnels le potentiel de l’IA générative dans des tâches variées : rédaction de comptes-rendus, aide à la traduction, brainstorming, support client automatisé, etc. Rapidement, des entreprises ont intégré ces modèles dans leurs workflows : on a vu apparaître des assistants virtuels intégrés aux suites bureautiques, des fonctionnalités d’auto-complétion de code pour les développeurs, ou encore des chatbots intelligents sur les sites web d’e-commerce. En ce début 2025, on estime que plus d’une entreprise sur deux utilise déjà l’IA d’une manière ou d’une autre.
Le télétravail et la transformation numérique accélérée par la pandémie ont aussi préparé le terrain : les équipes sont plus dispersées et outillées, ce qui facilite l’adoption de solutions d’IA en ligne. Par exemple, certaines réunions d’équipe sont maintenant automatiquement transcrites et résumées par IA, des recruteurs utilisent des logiciels à IA pour trier des CV, et des agents du support client collaborent avec des chatbots qui leur suggèrent des réponses.
Dans de nombreuses professions, l’IA agit déjà comme un assistant. Le médecin dispose d’une IA pour l’aider à interpréter un examen médical, l’architecte peut générer en quelques clics des esquisses variant un projet, l’analyste marketing voit son tableau de bord enrichi de projections prédictives produites par machine learning. Un quart des entreprises belges affirment par exemple utiliser au moins une application d’IA au travail en 2025, soit une hausse de 80 % en un an. La productivité a commencé à grimper dans certains domaines grâce à ces outils. Selon McKinsey, cette vague d’IA pourrait doper significativement la productivité du travail, bien que les estimations varient sur l’ampleur exacte du gain.
On observe aussi que les compétences requises ont déjà commencé à évoluer. Les offres d’emploi mentionnent de plus en plus la maîtrise d’outils d’analyse de données, de Python ou de techniques d’IA. La culture technologique générale des professionnels monte en puissance – que ce soit par curiosité personnelle ou par nécessité, beaucoup ont appris les bases de ces nouvelles technologies. Cependant, cette transition en cours révèle une fracture : une partie des employés se forment et expérimentent d’eux-mêmes l’IA, tandis qu’une autre partie reste réticente ou mal formée. Près de 2 salariés européens sur 3 estiment ne pas recevoir une formation suffisante à l’IA de la part de leur employeur. Autrement dit, l’IA est là, mais tout le monde n’a pas encore les moyens d’en tirer profit pleinement – ce qui rejoint l’avertissement « personne n’est prêt ».
Ce qui ne changera pas : l’humain au cœur du travail
Malgré l’enthousiasme (ou l’inquiétude) légitime autour de l’IA, tout ne va pas changer du jour au lendemain dans nos emplois. Il est crucial d’identifier ce qui pourrait ne pas changer, c’est-à-dire les invariants du monde du travail sur lesquels l’IA aura peu d’impact direct. En premier lieu : les facteurs purement humains. Les études s’accordent à dire que les tâches manuelles, les activités nécessitant du contact humain et les décisions stratégiques complexes resteront principalement du ressort des humains. Une machine ne remplacera pas de sitôt un artisan hautement qualifié, un soignant apportant empathie et présence, ou un manager devant arbitrer des choix délicats en intégrant des valeurs, de l’éthique ou des imprévus.
Par exemple, la relation client en personne, la négociation commerciale au plus haut niveau, le leadership d’équipe, la créativité artistique originale ou la gestion du changement organisationnel sont autant de domaines où l’IA sera un outil d’aide, mais pas un substitut complet. Votre coiffeur ou votre plombier utilisera peut-être des applications d’IA pour la gestion des rendez-vous ou du stock, mais l’exécution de la coupe ou de la réparation restera entre ses mains expertes. De même, un professeur pourra s’appuyer sur des tuteurs intelligents pour les exercices pratiques, mais l’art de motiver une classe et de transmettre la passion d’apprendre restera un savoir-faire humain.
Ensuite, les valeurs et aspirations profondes liées au travail ne changent pas fondamentalement. Les individus continueront à rechercher du sens, de la reconnaissance et du lien social dans leur vie professionnelle. L’IA peut bousculer les méthodes, mais les attentes humaines (s’épanouir, être utile, interagir avec autrui, évoluer dans sa carrière) demeurent. À cet égard, le rôle des managers en tant que coachs et leaders bienveillants restera essentiel pour fédérer les équipes dans un contexte de travail de plus en plus digitalisé. Un algorithme ne remplacera pas la culture d’entreprise ou l’esprit d’équipe.
Enfin, certaines professions seront relativement épargnées par l’IA car leur cœur de métier n’est pas automatisable facilement. Les « emplois peu qualifiés » au sens académique, notamment dans les services de proximité ou les métiers manuels, pourraient étonnamment être moins touchés que d’autres par l’IA générative. Paradoxalement, c’est souvent dans les emplois tertiaires intermédiaires (assistants administratifs, comptables, agents de back-office) que la part de tâches automatisables est la plus élevée, alors que le jardinier, l’aide à domicile ou le mécanicien continue de réaliser des tâches physiques complexes dans un environnement non structuré – un défi encore hors de portée pour l’IA actuelle.
En résumé, ce qui ne changera pas, c’est la nécessité de l’humain. L’IA pourra augmenter l’efficacité, mais la touche finale, la supervision et l’approbation resteront humaines dans de nombreux processus, ne serait-ce que pour des raisons de responsabilité légale ou de confiance. Cette réalité doit rassurer : l’humain garde une place centrale, même dans un monde du travail bouleversé par la technologie.
Les incertitudes : ce que l’on ne sait pas encore
Si une chose est sûre, c’est que rien n’est complètement sûr concernant l’impact futur de l’IA. Il existe encore de nombreuses incertitudes quant à l’ampleur, le rythme et la nature exacte des changements sur le travail. D’abord, l’IA elle-même évolue sans cesse : on parle déjà d’IA générale (AGI) capable d’égaler l’intelligence humaine dans n’importe quelle tâche cognitive d’ici quelques années, mais ce délai reste très spéculatif. Les experts sont partagés – certains annoncent des avancées foudroyantes, d’autres soulignent les limitations actuelles (hallucinations des modèles, besoin de données massives, coûts énergétiques, etc.). Par exemple, Eric Schmidt lui-même a admis s’être trompé sur certains progrès attendus en six mois, signe que même les initiés peinent à prévoir précisément l’évolution de l’IA. L’incertitude technologique est donc réelle : une nouvelle découverte pourrait accélérer ou au contraire ralentir le rythme des transformations.
Ensuite, l’impact sur l’emploi fait l’objet de débats. Les études quantifient différemment la proportion d’emplois menacés ou créés, avec des fourchettes très larges. Certains travaux estiment que seulement 5 % des emplois seraient réellement automatisables à court terme, d’autres montent jusqu’à 30 %. De même, la capacité de l’économie à créer de nouveaux emplois pour compenser ceux détruits reste une inconnue partielle. L’histoire a montré que chaque révolution technologique finit par créer plus d’emplois qu’elle n’en détruit (effet de destruction créatrice), mais le décalage temporel entre destruction et création peut engendrer du chômage transitoire. Le timing et la gestion de cette transition sont incertains : verra-t-on d’abord des vagues de suppressions de postes avant que de nouveaux métiers émergent massivement ? Possiblement, oui.
Par ailleurs, les politiques publiques et la régulation introduisent des inconnues. L’Europe a par exemple introduit l'AI Act pour réguler l’IA, freinant certains usages et imposant des garde-fous (transparence des algorithmes, interdiction de certaines applications à risque, etc.). Si la régulation est stricte en Europe et plus souple ailleurs, cela pourrait-il retarder l’adoption de l’IA en Europe par rapport aux États-Unis ou à la Chine ? Ou au contraire, instaurer une confiance accrue et donc une adoption durable ? Difficile à prédire. De même, les investissements des entreprises dépendront de la conjoncture économique : un ralentissement marqué pourrait retarder l’intégration de nouvelles technologies, là où une concurrence féroce pourrait au contraire forcer la main pour innover vite.
Enfin, il y a l’acceptation sociale. L’IA fera-t-elle face à une résistance (comme on le voit déjà dans certains mouvements refusant les chatbots ou réclamant des droits d’auteur pour la création générée) ? Ou bien sera-t-elle massivement adoptée par des travailleurs qui y verront un gain ? Les sondages montrent des attitudes mitigées : en Europe, environ 68 % des employés s’attendent à une diffusion croissante de l’IA, mais dans certains pays du Sud, plus de 75 % des travailleurs craignent pour leur emploi à cause de l’IA. Ces craintes, si elles s’amplifient, pourraient ralentir l’adoption (par exemple via des mouvements sociaux ou un refus des employés de collaborer avec l’IA). L’inconnu réside dans la manière dont humains et IA cohabiteront : complémentarité harmonieuse, ou méfiance et conflits ? Probablement un peu des deux, selon les contextes.
En somme, bien que la direction générale soit claire (une transformation du travail par l’IA), l’ampleur exacte et la trajectoire restent incertaines. D’où l’importance de rester agile et flexible dans sa stratégie de carrière ou de gestion d’entreprise, afin de pouvoir ajuster le cap en fonction de l’évolution réelle des technologies et de la société.
Panorama de l’impact de l’IA sur le monde du travail en Europe
Le monde du travail européen est d’ores et déjà à l’aube d’une transformation généralisée sous l’effet de l’IA. Mais cet impact prendra des formes variables selon les secteurs, les pays et les catégories socio-professionnelles. Dressons un panorama des grandes tendances en Europe.
Tous les secteurs sont concernés, mais à des degrés divers. Les secteurs technologiques et financiers sont en pointe dans l’adoption de l’IA (automatisation du support client, trading algorithmique, analyse prédictive, etc.). L’industrie manufacturière poursuit sa mutation en « industrie 4.0 », avec des robots intelligents, de la maintenance prédictive et de l’optimisation en temps réel des chaînes de production. Les services, longtemps préservés, voient maintenant l’IA entrer dans les banques, les assurances, le juridique, le marketing ou les ressources humaines. Même des métiers très intellectuels comme les avocats ou les médecins utilisent l’IA en assistance (recherche d’informations, aide au diagnostic). D’après une étude PwC, 64 % des PDG mondiaux pensent que l’IA générative augmentera la productivité de leurs employés, ce qui témoigne d’une attente forte dans tous les domaines.
Les pays européens présentent cependant des rythmes d’adoption différents. Le baromètre EY 2024 souligne que l’Espagne, la Suisse ou l’Italie figurent parmi les pays où le plus de salariés ont déjà expérimenté l’IA (plus de 75 % des employés). À l’inverse, aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Autriche, cette proportion est plus proche de deux tiers – ce qui reste élevé. La France se situe dans une moyenne haute. Ces différences s’expliquent par le tissu économique (par exemple l’Espagne a beaucoup de services clients délocalisés, domaine où l’IA est rapidement adoptée), ainsi que par la culture et la perception de l’IA. Dans les pays d’Europe du Nord, l’inquiétude face à l’IA est relativement modérée (seulement ~60 % craignent des pertes d’emplois), tandis qu’en Europe du Sud la crainte est plus forte (jusqu’à 80 % au Portugal). Cette disparité peut provenir des taux de chômage existants (plus élevés au Sud, rendant la menace plus palpable) et du type d’emplois dominants (les économies à forte proportion d’emplois qualifiés voient davantage l’IA comme une opportunité d’efficacité que comme un danger immédiate).
Les profils de travailleurs en Europe vont aussi être différemment touchés. Les cadres supérieurs semblent pour l’instant les premiers exposés – et utilisateurs – de l’IA : plus de 84 % des cadres dirigeants européens disent avoir déjà utilisé des applications d’IA, contre 67 % des non-cadres. Cela s’explique : les dirigeants et managers ont accès à plus d’outils, et cherchent à innover dans leur organisation. Les employés d’exécution, eux, suivent selon les outils mis à leur disposition. On peut craindre que l’IA accroisse certaines inégalités sur le marché du travail si une partie de la main-d’œuvre (souvent les plus qualifiés) en tire profit pour gagner en performance, alors que d’autres stagnent. D’où l’importance de la formation à tous les niveaux, afin de démocratiser l’accès aux compétences IA.
En Europe, l’IA pourrait aussi aggraver la “fracture des compétences” entre pays. Déjà, les entreprises peinent à recruter suffisamment de data scientists, d’ingénieurs IA ou d’experts en cybersécurité – la fameuse guerre des talents. Si certaines nations forment massivement à ces nouveaux métiers et pas d’autres, on pourrait voir une concentration des investissements IA dans quelques hubs (par exemple, l’Allemagne ou la France, voire la Scandinavie) pendant que d’autres pays subissent l’automatisation importée sans disposer des spécialistes locaux. L’Union européenne encourage donc le partage de connaissances et le financement de programmes de formation pour diffuser les compétences partout sur le continent.
Par ailleurs, l’Europe sociale offre un contexte particulier : les protections des salariés y sont plus fortes qu’ailleurs (conventions collectives, droits du travail, etc.). Il est donc probable que l’impact sur l’emploi y prenne la forme de requalifications et de transitions internes plutôt que de licenciements secs en masse. Là où une entreprise américaine pourrait supprimer rapidement des postes automatisés, une entreprise européenne sera enclin à reclasser ou former les employés vers de nouveaux rôles. De plus, certaines pénuries de main-d’œuvre (liées au vieillissement démographique en Europe) pourraient atténuer l’effet négatif de l’IA : par exemple, si des postes sont automatisés dans un secteur où il manquait déjà de candidats humains, l’IA comblera un vide plus qu’elle ne créera du chômage. Ainsi, dans des pays comme l’Allemagne confrontés à un manque d’ingénieurs ou de soignants, l’IA sera une alliée pour maintenir la productivité malgré la pénurie.
En résumé, le panorama européen est contrasté : partout l’IA va changer le travail, mais l’ampleur du bouleversement dépendra du tissu économique local, de la culture vis-à-vis de la technologie, et des politiques d’accompagnement mises en place (formation, transition…). Tous les professionnels, du nord au sud de l’Europe, gagneront à suivre de près ces évolutions pour ne pas se laisser distancer.
Conclusion : l’humain au centre d’un travail réinventé
L’irruption rapide de l’intelligence artificielle dans tous les aspects du travail constitue sans aucun doute l’un des plus grands bouleversements depuis la révolution industrielle. « Personne n’est prêt », disait en substance l’ancien patron de Google : il est vrai que nous avançons en terrain encore partiellement inconnu. Cependant, les analyses et tendances que nous avons parcourues montrent qu’il est possible de se préparer et d’orienter positivement cette révolution. Oui, l’IA va tout changer ou presque – de la nature des tâches quotidiennes aux compétences requises, en passant par les structures d’entreprise. Mais non, tout ne va pas disparaître ni se robotiser : la composante humaine restera cruciale, sous de nouvelles formes.
En Europe, les professionnels de tous niveaux hiérarchiques devront naviguer avec agilité dans cette transition. Les jeunes devront cultiver leur soif d’apprendre, les profils intermédiaires renouveler leurs compétences, les cadres expérimentés faire preuve de leadership éclairé, et les dirigeants guider avec vision et responsabilité. Le monde du travail de demain sera ce que nous en ferons : une collaboration harmonieuse entre l’humain et la machine, ou une source de tension – le choix dépend en grande partie de notre capacité à anticiper, nous former et nous adapter dès aujourd’hui.
Les entreprises ont un rôle déterminant à jouer : investir dans la formation, accompagner les mobilités internes, redéfinir les rôles avec transparence, instaurer un cadre éthique à l’usage de l’IA. Les individus ne sont pas impuissants pour autant : chacun peut, à son échelle, prendre en main son employabilité future en développant les compétences techniques et humaines idoines, et en adoptant une attitude ouverte face au changement. Dans ce contexte, se faire accompagner par des experts peut faire la différence. Faire appel à un coach en management ou un coach carrière peut aider à y voir clair dans son projet professionnel, à identifier ses forces transposables et à lever les freins psychologiques face à l’IA. Les cabinets de conseil en management comme Chapman & Chapman travaillent déjà avec les organisations et les individus pour les préparer à ces transformations, en mettant l’accent sur le développement des talents, la conduite du changement et la préservation du facteur humain comme levier de performance.
En conclusion, loin d’être une prophétie dystopique où les robots remplaceraient l’homme, l’IA offre surtout l’opportunité de réinventer le travail. Moins de tâches ingrates, plus de challenges stimulants ; moins de routine, plus de créativité ; moins de barrières, plus de collaborations (y compris avec la machine). Pour peu que l’on s’y prépare activement, l’avenir du travail s’annonce comme un terrain d’innovation et d’épanouissement renouvelé. Comme le souligne l’article des Échos, le changement est inévitable et rapide – mais avec les bonnes stratégies, chacun peut trouver sa place dans ce nouveau paradigme du travail augmenté. Êtes-vous prêt à devenir, vous aussi, un acteur de ce futur du travail ? À vous de jouer dès maintenant, en développant vos compétences, votre adaptabilité et votre état d’esprit : l’IA n’attend pas, mais elle n’attend que nous pour donner le meilleur d’elle-même, avec nous.
Prenez rendez-vous sans plus attendre ici.
Chapman & Chapman SAS
Stratégie et juridique pour vos projets d'affaires.
© 2025. All rights reserved.
SIRET 94269043900016