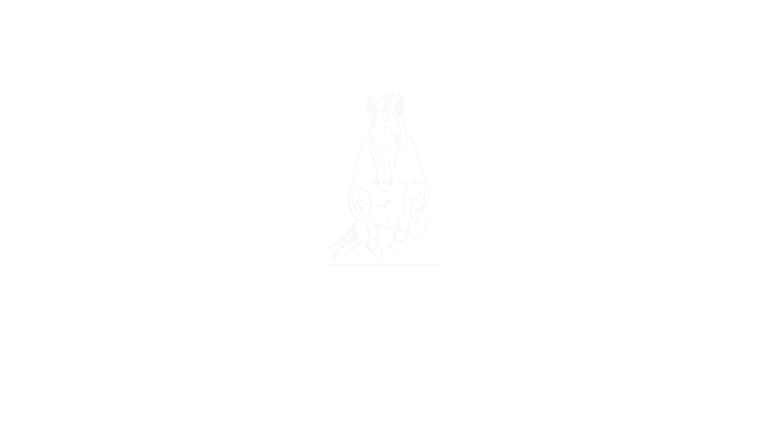IA : comment elle va transformer le travail et comment s’y préparer - partie 2
Chaque professionnel se demande comment l’IA va influencer sa carrière. Les effets et les préoccupations diffèrent selon la séniorité. Voici un tour d’horizon des enjeux spécifiques pour un jeune en premier emploi, un profil intermédiaire, un cadre expérimenté et un dirigeant.
COACHINGIATECHNOLOGIECARRIÈREDÉVELOPPEMENT PERSONNEL


Chaque professionnel se demande comment l’IA va influencer sa carrière. Les effets et les préoccupations diffèrent selon la séniorité. Voici un tour d’horizon des enjeux spécifiques pour un jeune en premier emploi, un profil intermédiaire, un cadre expérimenté et un dirigeant.
Début de carrière : les jeunes en premier emploi face à l’IA
Pour les jeunes qui entrent tout juste sur le marché du travail – jeunes diplômés ou premiers emplois – l’IA fait partie du paysage « par défaut ». Cette génération arrive dans des entreprises où ChatGPT, les assistants vocaux ou l’automatisation font déjà partie des outils disponibles. L’opportunité pour eux est de capitaliser sur leur aisance technologique : natifs du numérique, ils peuvent rapidement maîtriser ces nouveaux outils et se démarquer par leur capacité à innover. Par exemple, un jeune marketeur qui saura utiliser une IA pour analyser les tendances sur les réseaux sociaux ou générer des idées de contenu aura une longueur d’avance. Il en va de même d’un jeune développeur qui intègre l’IA dans son codage pour gagner en efficacité.
Cependant, le défi pour les juniors est double. D’une part, ils doivent veiller à acquérir les fondamentaux du métier malgré l’IA. Il serait tentant de trop compter sur la machine sans développer ses propres compétences de base. Or, un analyste financier débutant doit apprendre à faire un budget à la main avant de se fier à un algorithme, afin de bien comprendre les rouages du métier. D’autre part, les jeunes risquent de voir certaines tâches d’apprentissage automatisées. Autrefois, un jeune consultant pouvait passer des heures à faire des recherches documentaires ou des analyses Excel – un labeur formateur. Aujourd’hui, l’IA peut réaliser 80 % de ces tâches en quelques minutes. Le risque est de perdre des occasions d’apprentissage par la pratique. Les premiers échelons de la carrière devront donc être repensés pour offrir suffisamment de projets formatteurs aux juniors, en compensant l’automatisation par d’autres missions (par exemple, plus de travail d’équipe, de terrain, de créativité).
Les compétences comportementales (soft skills) seront aussi déterminantes dès le début. Un jeune diplômé qui fait preuve de curiosité, d’adaptabilité et d’aisance à collaborer avec des IA aura un profil très attractif. Il faut donc cultiver un esprit d’apprentissage continu : l’école est finie, mais la formation continue ne fait que commencer, car les outils évolueront constamment. Sur ce point, les coachs de carrière peuvent être d’un grand secours pour aider les jeunes à élaborer un plan de développement de compétences sur leurs premières années (on pense notamment à un coach carrière qui oriente sur les formations en ligne utiles, les certifications à viser, les expériences à valoriser). Enfin, le conseil vaut pour tous mais particulièrement pour cette tranche d’âge : soignez votre réputation en ligne et votre marque personnelle. Dans un monde où l’IA peut vérifier vos réalisations et où les recruteurs utilisent LinkedIn et d’autres outils pour vous évaluer, construire tôt une image professionnelle (portfolio de projets, veille sur un blog, etc.) vous donnera une visibilité bienvenue.
Milieu de carrière : profils intermédiaires et experts techniques
Les professionnels en milieu de carrière – avec, disons, 5 à 15 ans d’expérience – forment souvent le cœur opérationnel des entreprises. Ils ont accumulé du savoir-faire dans leur domaine et encadrent parfois les plus jeunes. Pour eux, l’IA arrive à un moment charnière où ils maîtrisent leur métier, mais voient celui-ci évoluer brusquement. L’avantage des profils intermédiaires, c’est leur expérience : ils comprennent les enjeux métiers mieux que quiconque, et peuvent donc identifier comment l’IA peut concrètement améliorer les processus ou, au contraire, où elle peut commettre des erreurs. Leurs compétences techniques ou sectorielles sont précieuses pour entraîner, superviser et affiner les systèmes d’IA (on aura toujours besoin d’un expert humain pour valider les résultats d’une IA spécifique à un domaine pointu).
Par ailleurs, étant souvent opérationnels ou experts techniques, ces professionnels peuvent gagner en productivité individuelle grâce à l’IA. Un architecte d’intérieur avec 10 ans de métier peut utiliser l’IA pour générer rapidement des variantes de designs et, fort de son expérience, sélectionner la meilleure. Un expert comptable peut lancer des analyses automatiques et concentrer son temps sur l’interprétation fiscale fine. Ainsi, bien utilisée, l’IA peut être un allié pour monter en gamme dans les missions réalisées. Moins de temps sur les tâches basiques, plus sur l’expertise et le conseil.
Le défi principal pour cette catégorie est d’éviter le piège de l’obsolescence des compétences. Après 10 ans dans la même spécialité, on pourrait se reposer sur ses lauriers… or l’IA vient rebattre les cartes. Il est essentiel pour ces professionnels de mettre à jour leurs compétences régulièrement. Beaucoup ont déjà dû le faire avec la transformation digitale (par exemple, un commercial traditionnel a dû apprendre à utiliser un CRM et LinkedIn il y a quelques années) ; avec l’IA, une nouvelle phase d’adaptation commence. Certains métiers techniques peuvent se voir bousculés : un responsable des études de marché doit se familiariser avec les outils d’analytics augmentée ; un traducteur professionnel doit apprendre à se servir de moteurs de traduction comme d’une aide et se repositionner sur de la relecture experte ou de la traduction littéraire haut de gamme.
Il est conseillé aux profils intermédiaires de prendre les devants : identifier dans leur domaine quelles sont les dernières innovations IA, tester des outils, éventuellement suivre des formations ciblées (beaucoup de MOOC existent pour acquérir des bases en data science, en IA appliquée à tel secteur, etc.). Les entreprises apprécient les collaborateurs proactifs qui montent en compétence d’eux-mêmes. Les salariés peuvent aussi solliciter leur employeur pour bénéficier de plans de formation continue sur ces sujets : d’après le WEF, 77 % des employeurs envisagent justement de former leurs équipes aux compétences liées à l’IA. C’est une occasion à saisir.
Enfin, ces professionnels doivent parfois redéfinir leur rôle. Passer de **« faire » à « faire-faire avec l’IA ». Par exemple, un chef de projet marketing avec 8 ans d’expérience va moins concevoir lui-même chaque visuel publicitaire, mais orchestrer un outil génératif et des designers juniors pour le faire. Cela implique de développer des compétences de gestion de projet et de mentorat, en plus de la maîtrise technique. En ce sens, leur rôle se rapproche de celui de cadre, ce qui est souvent le chemin naturel à ce stade : l’IA peut donc être vue comme une opportunité de progresser vers plus de responsabilités. Un coach en management peut accompagner cette transition en aidant le professionnel à développer son leadership et à repenser sa valeur ajoutée dans l’entreprise à l’heure de l’IA (déléguer les tâches automatisables, renforcer les autres). L’important est de rester acteur du changement et non le subir passivement.
Cadres expérimentés : managers et experts seniors
Les cadres expérimentés (souvent 15-25 ans d’expérience ou plus) – qu’ils soient managers de haut niveau ou experts seniors – abordent l’IA avec à la fois beaucoup d’attentes et peut-être une certaine appréhension. Ce qui change pour eux : leur rôle de décideur et de mentor prend encore plus de poids. Traditionnellement, un cadre expérimenté est là pour apporter de la vision, trancher les questions difficiles, transmettre la culture de l’entreprise et coacher les plus jeunes. Rien de tout cela ne disparaît, bien au contraire. Avec l’IA, il doit en plus montrer l’exemple en matière d’adaptation technologique et guider ses équipes à travers la transformation.
D’un point de vue très pratique, un manager expérimenté aura à intégrer l’IA dans les processus de son unité ou département. Il lui faudra choisir les bons outils, les mettre en place, ajuster l’organisation du travail. Par exemple, le directeur d’un centre de support client senior peut décider d’implémenter un chatbot IA pour les demandes de niveau 1 : il devra alors redéployer ses conseillers humains sur des cas plus complexes ou sur de la fidélisation proactive. Son expérience lui servira à anticiper les écueils (un chatbot mal entraîné peut faire des erreurs – il faut prévoir un filet de sécurité humain) et à gérer le changement auprès de l’équipe (certains collaborateurs peuvent craindre pour leur poste ou avoir du mal avec la nouvelle interface). Le cadre senior doit donc faire preuve de leadership et de pédagogie pour embarquer tout le monde dans la transition numérique.
Le leadership à l’ère de l’IA requiert aussi une dimension éthique et stratégique. Les cadres expérimentés seront sollicités pour répondre à des questions comme : “Jusqu’où utiliser l’IA dans nos décisions ? Quelle est la bonne place de l’humain ? Comment garantir la confidentialité des données si on utilise tel service en ligne ?”. Ils devront définir des politiques d’utilisation de l’IA internes, en accord avec la stratégie de l’entreprise et la réglementation. Par exemple, un directeur juridique senior pourra établir des guidelines pour que les juristes de son équipe n’utilisent l’IA que pour de la recherche documentaire non confidentielle, afin d’éviter toute fuite de donnée client dans un modèle cloud. De même, un manager RH expérimenté réfléchira aux implications déontologiques de l’usage d’IA dans le recrutement ou l’évaluation du personnel. Leur expérience sera précieuse pour faire preuve de discernement là où les plus jeunes manquent parfois de recul.
Pour les experts seniors, l’IA peut aussi être perçue comme une rivale potentielle si une partie de leur expertise est automatisée. Prenons un médecin radiologue de 25 ans de pratique : il voit arriver des IA capables de détecter certaines anomalies sur les images mieux qu’un humain. Doit-il s’en inquiéter ? Idéalement non : il doit collaborer avec l’IA pour améliorer encore le diagnostic, et non se sentir remis en cause. Mais cela demande un changement de mentalité. Il peut être déstabilisant, après des décennies à développer un savoir-faire, de voir une machine réussir en partie la même chose. Un effort de remise en question est nécessaire pour accepter de réapprendre de nouveaux outils, voire de nouvelles méthodes, même en étant expérimenté. La bonne nouvelle, c’est que la capacité d’apprentissage n’est pas l’apanage des jeunes. De nombreux cadres expérimentés se forment activement (on voit des directeurs suivre des formations en ligne sur la data science par exemple) pour rester à jour.
Le soutien de la direction générale et éventuellement d’un coaching exécutif peut s’avérer utile. Certaines entreprises proposent à leurs cadres seniors des formations de sensibilisation à l’IA, ou font intervenir des coachs en management pour accompagner les managers seniors dans l’adaptation de leur style de gestion. Chez Chapman & Chapman, par exemple, nous constatons que l’accompagnement personnalisé aide les cadres à “dédramatiser” l’IA et à y voir une opportunité de renforcer leur rôle plutôt qu’une menace. En fin de compte, l’IA ne remplace pas l’expérience accumulée ; elle la rend encore plus utile lorsqu’il s’agit de prendre des décisions complexes ou d’arbitrer des situations inédites que la machine ne sait pas gérer. Le mot d’ordre pour les cadres expérimentés sera donc leadership augmenté par l’IA, en combinant la puissance des données et des algorithmes avec leur jugement mûri par l’expérience.
Dirigeants : capitaines d’entreprise à l’heure de l’IA
Pour les dirigeants (membres de comités de direction, CEO, DG, etc.), l’IA est désormais un enjeu stratégique de premier plan. Le travail du dirigeant lui-même est impacté : il doit décider de la vision de son organisation face à l’IA, allouer des budgets, parfois réorienter son modèle d’affaires. Un dirigeant en 2025 ne peut plus se permettre de ne pas comprendre l’IA. Sans devenir technologue, il doit en saisir les opportunités et les risques à haut niveau. D’après une enquête récente, plus de 40 % des employeurs (donc les dirigeants) prévoient de réduire leurs effectifs grâce à l’IA dans les prochaines années, mais dans le même temps 77 % comptent former leurs collaborateurs pour les monter en compétence. Cette double statistique montre bien le dilemme et la responsabilité qui pèsent sur les dirigeants : arbitrer entre efficacité économique (l’IA pour gagner en productivité, potentiellement avec moins de personnel) et responsabilité sociale (investir dans la formation pour préserver l’emploi et évoluer avec ses équipes). Trouver le bon équilibre sera crucial pour maintenir la confiance des employés tout en restant compétitif.
Les dirigeants doivent également penser à la culture d’entreprise. L’introduction massive de l’IA peut bousculer la culture interne : peur du remplacement, perte de sens pour certains métiers, ou au contraire excitation devant l’innovation. C’est au leader de donner le cap et d’expliquer comment l’IA s’intègre dans la mission de l’organisation. Par exemple, le dirigeant d’une entreprise de conseil pourra communiquer en interne que l’IA servira à augmenter la capacité d’analyse des consultants, pour se concentrer sur le conseil à forte valeur ajoutée auprès des clients, sans intention de réduire les effectifs. La transparence sur les intentions et les plans est essentielle pour éviter la méfiance. Les meilleurs dirigeants en la matière sont souvent ceux qui impliquent leurs équipes dans la co-construction de la stratégie IA (groupes de travail, labs internes, formation de “champions IA” en interne…). Cela envoie le signal que l’IA est l’affaire de tous, pas un projet mené en secret par la direction.
Un autre aspect pour les dirigeants est la gestion des risques. L’IA apporte son lot de risques nouveaux : cyber-sécurité (imaginons qu’un hacker utilise l’IA pour attaquer nos systèmes), risque juridique (biais algorithmiques entraînant de la discrimination sans qu’on s’en rende compte, propriété intellectuelle des contenus générés par IA, etc.), risque d’image (bad buzz lié à une erreur d’IA dans un service public, par exemple). Le dirigeant doit s’assurer que ces risques sont identifiés et mitigés, en lien avec son comité de direction. Cela peut passer par la création de comités éthiques, l’embauche de spécialistes IA dans des postes clés, ou l’élaboration de plans d’urgence en cas de problème majeur (un peu comme on a des plans de continuité d’activité, on pourrait imaginer un plan en cas de défaillance soudaine d’un système d’IA critique). Les régulateurs s’attendent à ce que les entreprises fassent preuve de diligence dans l’usage de l’IA, et ce sera évalué au même titre que la conformité financière ou la sécurité du travail.
Enfin, pour le dirigeant lui-même, l’IA peut être un outil de pilotage formidable. Des dashboards intelligents peuvent agréger des indicateurs clés venant de toutes les branches de l’entreprise en temps réel, des analyses prédictives peuvent l’alerter sur des tendances de marché ou des signaux faibles, etc. Le risque serait de se noyer dans la data : le leader de demain devra garder une vue d’ensemble, faire confiance à l’IA pour la remontée d’information factuelle, mais garder son instinct et son intelligence contextuelle pour prendre les décisions complexes. La décision augmentée ne veut pas dire que l’algorithme décide ; cela signifie que le dirigeant dispose de la meilleure information possible pour décider. Sa vision et son expérience restent irremplaçables pour « trancher » lorsque les données sont contradictoires ou incomplètes.
En somme, les dirigeants sont les capitaines dans cette révolution : à eux de fixer le cap, d’équiper le navire (leur organisation) des meilleures technologies, de former l’équipage, et de naviguer prudemment mais résolument vers le futur du travail assisté par l’IA.
Missions, compétences et rôles : une évolution inéluctable avec l’IA
Que ce soit pour les juniors, les seniors, les techniciens ou les managers, l’IA va redéfinir les missions quotidiennes, exiger de nouvelles compétences clés et faire évoluer les rôles de chacun au sein des organisations.
Des missions automatisées, d’autres enrichies
Au niveau micro (la journée de travail type), beaucoup de missions ou tâches vont changer d’âme. Les tâches à faible valeur ajoutée, répétitives ou très formalisées seront de plus en plus prises en charge par des logiciels intelligents (automatisation). Un commercial n’aura plus à saisir manuellement ses comptes-rendus dans le CRM : une IA transcrira et résumera ses réunions automatiquement. Un technicien de maintenance industrielle recevra des alertes préventives d’une IA qui aura détecté une anomalie dans les capteurs, remplaçant ainsi les rondes systématiques de contrôle. En parallèle, les tâches qui ne sont pas automatisables facilement (celles qui requièrent créativité, adaptation, interaction humaine) deviendront proportionnellement plus importantes dans la journée. On peut parler d’enrichissement du contenu du travail humain : par exemple, le même commercial consacrera plus de temps à la stratégie de prospection personnalisée ou à la relation client, et le technicien focalisera son expertise sur les interventions complexes et l’amélioration continue des process. L’IA prend en charge la routine, l’humain se concentre sur l’exceptionnel ou l’expertise pointue.
Il faudra toutefois veiller à l’équilibre des charges de travail. On pourrait imaginer qu’en retirant 30 % de tâches simples à un employé, on remplisse immédiatement ce vide par 30 % de tâches complexes en plus. Mais l’attention humaine et la créativité ne sont pas extensibles à l’infini sur une journée de 8 heures. Il y a un vrai enjeu de qualité de vie au travail à surveiller : l’IA ne doit pas conduire à une sur-sollicitation cognitive des salariés sur des tâches toujours plus exigeantes sans temps de respiration. Les organisations devront calibrer les charges et probablement redéfinir certains objectifs. Par exemple, un conseiller client appuyé par IA peut traiter plus de demandes à l’heure, mais si chaque cas qu’il traite est complexe (puisque les simples sont résolus par le bot), la pression mentale augmente. Il faudra en tenir compte dans la fixation des KPI et le support apporté aux équipes (pauses, rotation des tâches, etc.).
Les compétences clés de demain : un mélange de high-tech et de soft skills
Qui dit évolution des missions dit évolution des compétences requises. Quelles seront les compétences phare à l’ère de l’IA ? Les enquêtes internationales et les cabinets de conseil s’accordent sur un point : il faudra allier compétences techniques (hard skills) et compétences comportementales (soft skills).
D’un côté, les compétences technologiques seront incontournables. On pense bien sûr aux compétences directes en IA et Big Data : savoir manipuler des données, comprendre le fonctionnement de base des algorithmes, pouvoir interagir avec un système d’IA (par exemple, bien rédiger des prompts pour obtenir ce qu’on veut d’un modèle de langage). Mais pas besoin d’être data scientist pour autant : une culture numérique élargie sera attendue de tous. Cela inclut la cybersécurité (comprendre comment protéger les informations), la littératie numérique (être à l’aise avec divers outils software), et une aisance à apprendre de nouveaux outils en continu. Le Future of Jobs Report 2025 identifie ainsi parmi le Top 10 des compétences en croissance : « IA et Big Data », « Analyse et pensée analytique », « Culture technologique », « Réseaux et cybersécurité ». Même si l’on n’est pas spécialiste, il faudra avoir assez de bases pour collaborer efficacement avec les experts et avec les machines.
De l’autre côté, les soft skills prennent une importance démultipliée. Pourquoi ? Parce que ce sont précisément les compétences que les machines n’ont pas (ou pas encore) et qui vont devenir le facteur différenciant chez un candidat ou un collaborateur. Parmi les plus citées : la pensée créative (imaginer des solutions nouvelles, sortir du cadre, là où l’IA excelle à analyser l’existant mais pas à inventer ex nihilo), la résilience, flexibilité et agilité (pour s’adapter en permanence aux changements induits par la technologie et le marché), la curiosité et l’apprentissage continu (car on devra sans cesse mettre à jour ses connaissances – un état d’esprit d’étudiant à vie), le leadership et l’influence sociale (pour mobiliser les équipes, convaincre, négocier, tout ce qui relève de l’humain), ou encore la communication interpersonnelle. La gestion du temps, l’intelligence émotionnelle, la capacité à collaborer en équipe dispersée… toutes ces qualités, déjà prisées aujourd’hui, deviendront primordiales. Les entreprises recherchent des profils “techno-humains”, si l’on peut dire : capable de comprendre un logiciel et de travailler en harmonie avec, mais aussi capable d’interagir avec ses semblables de façon empathique et efficace. Sans surprise, 40 % des compétences clés devraient changer d’ici 2030 selon les employeurs – une proportion énorme qui montre l’ampleur du reskilling à entreprendre.
Voici, à titre d’illustration, quelques compétences du futur souvent mises en avant :
Adaptabilité et apprentissage continu : être capable de se former en continu, de passer d’un outil à l’autre, de rebondir face à de nouvelles méthodes de travail.
Pensée critique et analytique : savoir questionner les résultats d’une IA, vérifier des informations, raisonner logiquement pour prendre des décisions éclairées (ne pas prendre pour argent comptant tout ce que dit la machine).
Créativité et innovation : apporter une vision nouvelle, combiner des idées, concevoir de nouveaux produits, services ou approches – souvent en s’inspirant des possibilités offertes par l’IA mais en allant au-delà.
Communication et collaboration : bien travailler en équipe, souvent dans des configurations hybrides (humains + IA). Par exemple, expliquer à un collègue non-technique ce qu’une analyse IA signifie, ou inversement être le relais des besoins du terrain auprès d’une équipe data.
Leadership et gestion du changement : que l’on soit manager ou non, savoir guider les autres, faire preuve d’initiative et être moteur positif dans la transformation (plutôt que de la subir). Convaincre, former, être pédagogue sur les nouveaux outils, etc.
Compétences métiers approfondies : paradoxalement, plus l’IA “commoditise” certaines connaissances, plus on valorisera l’expertise humaine pointue dans un domaine. Donc continuer à approfondir son domaine métier est une compétence en soi (sachant que l’IA se chargera des bases, l’humain doit pousser vers le haut niveau).
Gestion des talents et intelligence sociale : surtout pour les managers, savoir développer les autres, détecter les potentialités, créer un environnement de travail épanouissant – des choses qu’aucune IA ne saura faire pour vous en tant que leader d’équipe.
En Europe, on voit déjà émerger des programmes de formation mettant l’accent sur ce mix de compétences. Par exemple, des masters ou MOOCs en « management de l’IA » combinent cours techniques et modules de communication/éthique. Les salariés peuvent aussi faire valoir leurs soft skills via des certifications (il en existe sur la gestion de projet agile, la communication non violente, etc.) tout aussi bien que des diplômes techniques. En bref, pour rester employable et évoluer dans sa carrière, il faudra sans doute sortir de sa spécialité initiale pour devenir un professionnel plus complet. Cette polyvalence techno-humaine sera la clé de la résilience professionnelle.
Des rôles qui évoluent et de nouveaux métiers
Enfin, l’organigramme des entreprises et la définition des rôles vont connaître un glissement progressif. Certains rôles traditionnels verront leur contenu modifié :
Les managers deviendront davantage des coachs et des coordinateurs homme-machine. Ils auront moins de tâches de reporting (automatisé par l’IA) et plus de tâches de pilotage stratégique et humain.
Les experts métiers travailleront main dans la main avec des experts data/IA. On voit dans certaines sociétés la création de binômes (par exemple un médecin + un data scientist pour concevoir ensemble un outil d’aide au diagnostic). L’expert métier devra connaître un peu de data, et l’expert data devra comprendre le métier pour que la collaboration produise des résultats.
Les fonctions support (RH, finance, logistique…) intègreront de plus en plus l’IA dans leurs workflows. Le responsable RH aura sous son aile un système d’IA pour présélectionner les CV, le responsable financier un outil d’IA pour la détection d’anomalies comptables. Leur rôle sera d’utiliser ces assistants pour se concentrer sur l’interprétation et la décision finale.
De nouveaux métiers apparaissent aussi. Certains existaient timidement et explosent : par exemple les data analysts, ingénieurs machine learning, spécialistes en cybersécurité IA, etc., très demandés. Mais aussi des rôles inédits : Prompt designer/engineer (spécialiste de la formulation des requêtes pour les IA génératives afin d’obtenir le meilleur résultat), AI trainer (dont la mission est d’entraîner et d’ajuster les modèles d’IA avec des retours humains, proche d’un « enseignant pour IA »), éthicien de l’IA (pour veiller au respect des valeurs et de la conformité éthique des usages de l’IA). Même au niveau intermédiaire, on voit surgir des postes du type “Automation Lead” ou “Evangelist IA interne” chargés de promouvoir et d’accompagner l’adoption des outils dans une entreprise.
Ces nouveaux rôles témoignent d’une chose : la place de l’humain se redéfinit mais ne disparaît pas. Simplement, les humains occuperont plus souvent des postes de supervision, de conception, de contrôle, d’accompagnement, tandis que la partie exécution simple sera en partie déléguée aux machines. On parle parfois d’organisation augmentée : une équipe formée d’humains et d’IA collaborant en temps réel. Dans ce contexte, chaque collaborateur humain doit se demander : “Quelle est ma valeur ajoutée par rapport à l’IA ? Qu’est-ce que je peux apporter d’unique ?”. La réponse oriente souvent vers davantage de créativité, de relationnel, de multidisciplinarité. Les coachs en management conseillent d’ailleurs aux organisations de revisiter régulièrement les fiches de poste et les processus pour identifier ce qui pourrait être fait autrement grâce à l’IA et comment repositionner les talents en conséquence. C’est un chantier continu, pas une transformation ponctuelle.
En définitive, les missions, compétences et rôles dans le travail de demain seront plus évolutifs que jamais. La description de poste figée tend à devenir obsolète, remplacée par une agilité des attributions. L’apprentissage en continu sera intégré à chaque rôle. Et chacun aura potentiellement un coéquipier IA pour l’assister – un peu comme l’ordinateur est devenu un compagnon de travail indispensable depuis 30 ans, l’IA sera le nouveau standard. L’intelligence augmentée (l’association de l’humain et de l’IA) deviendra la norme de performance. À nous, travailleurs, de nous y préparer et d’en tirer le meilleur.
Recommandations concrètes pour se préparer à l’ère de l’IA
Face à l’ampleur des changements décrits, il est normal de se sentir à la fois fasciné et peut-être inquiet. Comment s’y préparer concrètement, en tant que professionnel ? Voici quelques recommandations pratiques pour anticiper les mutations et garder une longueur d’avance sur la transformation en cours :
Adopter une posture d’apprentissage continu : Consacrez du temps chaque semaine ou chaque mois à vous former sur l’IA et les nouvelles technologies de votre secteur. Cela peut passer par des formations en ligne (MOOC), des ateliers internes, de la veille technologique (lire des articles, suivre des experts sur LinkedIn, etc.). L’important est de rester curieux. Par exemple, essayez par vous-même des outils comme ChatGPT ou d’autres IA liées à votre métier, pour en comprendre les forces et limites. Plus vous vous familiarisez tôt, plus vous serez à l’aise quand ces outils deviendront monnaie courante.
Développer ses soft skills : Comme vu plus haut, les compétences humaines sont cruciales. Identifiez 1 ou 2 soft skills que vous pourriez améliorer et entraînez-vous. Par exemple, si vous n’êtes pas à l’aise en public, inscrivez-vous à une formation en prise de parole. Si vous sentez que vous manquez de créativité, pratiquez des exercices de brainstorming, sortez de votre zone de confort intellectuelle (lisez sur des sujets variés, pratiquez une activité artistique). Si l’adaptabilité n’est pas votre fort, challengez-vous en changeant vos routines de travail ou en demandant du feedback pour progresser. Se connaître soi-même et évoluer sur le plan personnel vous donnera une assise solide pour naviguer dans un contexte professionnel changeant.
Tirer parti de l’IA dès maintenant : Plutôt que d’attendre que votre entreprise impose un outil, vous pouvez souvent commencer à expérimenter à petite échelle. Par exemple, utilisez des versions gratuites ou d’essai d’outils d’IA pour gagner du temps sur vos tâches : un agent conversationnel pour vous aider à rédiger une première ébauche de document, un outil de traduction pour vos emails en anglais, un service d’automatisation pour classer vos notes, etc. Attention bien sûr à respecter la confidentialité (n’utilisez pas de données sensibles dans des outils externes sans autorisation). L’idée est de vous familiariser et de montrer à votre entourage professionnel ce que cela peut apporter. En devenant force de proposition, vous valorisez votre profil. On peut imaginer qu’un comptable qui a automatisé via IA certaines parties de son reporting mensuel pourra partager sa méthode et devenir référent sur ce sujet.
Anticiper les changements dans votre métier : Renseignez-vous sur l’actualité de votre profession face à l’IA. Y a-t-il des conférences, des associations professionnelles, des rapports sur le sujet ? Par exemple, si vous êtes juriste, suivez les publications sur l’IA et le droit. Si vous êtes médecin, intéressez-vous aux positions de l’Ordre des médecins sur l’IA. Cela vous permettra de visualiser l’évolution probable de votre métier à 5-10 ans et d’orienter votre développement en conséquence. Si vous voyez que certaines compétences vont perdre de la valeur, commencez à en développer d’autres en complément. Cette gestion proactive de carrière est essentielle. Les coach carrière peuvent ici être d’un grand secours pour faire ce bilan et définir un plan d’action individuel.
Renforcer son réseau et échanger : Ne restez pas seul face à ces questions. Discutez avec vos collègues de ce qu’ils observent, partagez vos découvertes d’outils, organisez pourquoi pas un groupe de travail informel sur l’IA dans votre entreprise. À l’extérieur, participez à des meetups, webinaires ou forums en ligne sur le sujet. Le réseau permet de dédramatiser et de s’entraider. Par exemple, un groupe de managers pourrait partager chaque mois les expérimentations menées avec leurs équipes. Ensemble, on trouve souvent de meilleures idées et on se motive mutuellement à avancer.
Impliquer son employeur : Les entreprises ont tout intérêt à accompagner leurs salariés dans cette montée en compétence – proposez, si possible, des initiatives internes. Par exemple : la mise en place d’ateliers de formation à un nouvel outil IA, la création d’un lab innovation où les volontaires testent de nouveaux usages, la négociation de temps dédié à la formation dans les objectifs annuels… Si votre entreprise est un peu attentiste, prenez les devants en suggérant ces idées. Un employeur responsable devrait entendre ce message. Après tout, 64 % des dirigeants européens s’attendent à ce que l’IA ait un impact positif mais reconnaissent que leurs équipes ne sont pas prêtes sans formation adéquate. En montrant votre volonté de vous former, vous envoyez un signal positif et vous pourriez bénéficier d’un soutien (financement de formation, etc.).
Accepter de changer de voie si nécessaire : Parfois, se préparer à l’IA peut aussi signifier repenser son orientation. Si votre métier risque de disparaître ou de fortement se réduire, envisagez comment vos compétences pourraient être transférées vers un domaine en croissance. Un exemple concret : si vous êtes assistant de direction et que vous craignez l’automatisation de nombreuses tâches administratives, vos compétences d’organisation et de communication pourraient vous permettre de migrer vers des fonctions de gestion de projet ou d’assistance commerciale où l’humain reste crucial. Il ne s’agit pas de paniquer et de tout quitter sur un coup de tête, mais d’avoir un coup d’avance sur une éventuelle transition. Se former à un nouveau métier en douceur en parallèle de son poste actuel peut être une stratégie payante.
En appliquant ces conseils, vous deviendrez acteur de votre évolution professionnelle dans ce contexte d’IA. Rappelez-vous que l’objectif n’est pas de tout maîtriser de suite, mais d’entrer dans une démarche d’amélioration continue. L’IA évolue ? Vous aussi. Ce qui nous amène à un dernier point crucial : rester positif et ouvert d’esprit. Plutôt que de voir l’IA comme une menace, voyez-la comme une occasion de vous débarrasser de ce qui vous ennuie dans votre travail pour vous concentrer sur ce qui vous passionne ou ce qui compte vraiment. Le bon état d’esprit c’est de se dire « Comment puis-je tirer parti de l’IA pour atteindre mes objectifs et m’épanouir davantage ? ».
Conclusion : se préparer à l'ère de l'IA, un passage indispensable
L'IA est bien réelle, et, qu'on le veuille ou non, va fortement impacter le monde du travail. L'humain doit apprendre à travailler avec l'IA - et non contre elle.
Chez Chapman & Chapman, nous accompagnons les dirigeants et leurs équipes dans cette transition. Pour en apprendre plus sur nos solutions, prenez rendez-vous sans attendre ici.
Chapman & Chapman SAS
Stratégie et juridique pour vos projets d'affaires.
© 2025. All rights reserved.
SIRET 94269043900016