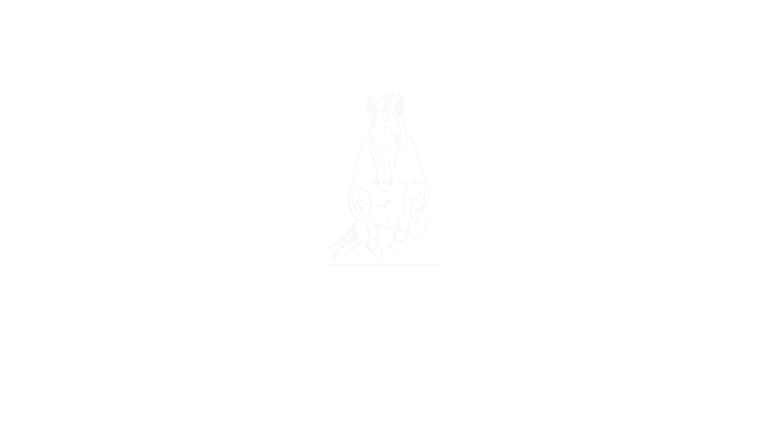Optimisation fiscale : 3 leviers puissants que 90 % des entreprises ignorent encore
Les dirigeants de PME peuvent recourir à diverses techniques d’optimisation fiscale pour réduire légalement la charge d’impôt de leur entreprise. Il s’agit de montages conformes au droit fiscal, qui requièrent toutefois une mise en œuvre rigoureuse et des précautions pour éviter tout abus de droit ou redressement ultérieur.
JURIDIQUEFISCALITÉOPTIMISATION FISCALE


Les dirigeants de PME industrielles peuvent recourir à diverses techniques d’optimisation fiscale pour réduire légalement la charge d’impôt de leur entreprise. Il s’agit de montages conformes au droit fiscal, qui requièrent toutefois une mise en œuvre rigoureuse et des précautions pour éviter tout abus de droit ou redressement ultérieur.
Aujourd'hui, Legal Growth vous propose trois stratégies encore méconnues des entreprises pour optimiser leur fiscalité en toute légalité.
1. Mise en place d’un accord de propriété industrielle avec redevance interne
Technique
Cette technique consiste à isoler la propriété intellectuelle (brevets, marques, logiciels, savoir-faire industriel, etc.) dans une entité dédiée du groupe, puis à accorder à l’entreprise d’exploitation une licence d’utilisation de ces droits moyennant le paiement d’une redevance.
En pratique, une société (souvent une holding ou une filiale spécifique) détient les actifs de propriété industrielle, et les exploite en concédant des licences aux sociétés opérationnelles du groupe. Cela permet de centraliser la gestion des brevets et marques et de faire remonter une partie des bénéfices sous forme de royalties vers la structure détentrice des droits.
Juridiquement, le montage repose sur un contrat de licence de propriété industrielle (marque, brevet, etc.) conclu entre entités liées, dans le respect du Code de la propriété intellectuelle (pour la validité du contrat de licence) et du Code général des impôts (CGI) en matière de prix de transfert. L’administration fiscale considère en effet chaque entité comme indépendante, y compris en intragroupe, et exige une contrepartie réelle à toute licence octroyée. Ainsi, même entre sociétés sœurs ou entre une filiale et sa maison mère, l’octroi d’une licence doit être rémunéré de façon normale pour ne pas être requalifié en acte anormal de gestion (un avantage injustifié).
Les redevances versées par le licencié sont ainsi déductibles de son résultat imposable à l’IS, tandis que la société qui perçoit ces redevances les intègre dans son propre résultat imposable. Cependant, il n'est pas possible d'opter pour l'imposition au taux réduit de 10% codifié à l'article 238 du CGI, lequel est réservé aux opérations avec des tiers non-liés.
Mise en œuvre
1. Création ou désignation d’une entité détentrice des droits : La première étape consiste à choisir la structure qui portera la propriété industrielle. Il peut s’agir d’une holding existante ou d’une filiale créée ad hoc pour l’occasion. Cette société doit avoir pour objet social la gestion de droits de propriété intellectuelle (par exemple, une SAS de gestion de brevets et marques).
2. Apport ou cession des actifs immatériels : Les droits de propriété industrielle (brevets, marques, dessins, modèles, logiciels, etc.) utilisés par la PME sont transférés à la nouvelle structure. Juridiquement, cet apport peut se faire à la valeur de marché des actifs, soit via une cession taxable de la société d’exploitation vers la holding, soit via un apport en nature contre des titres (bénéficiant éventuellement d’un report d’imposition de la plus-value d’apport sous certaines conditions). Il convient de faire évaluer les actifs immatériels par un expert pour justifier leur valeur.
3. Conclusion d’un contrat de licence intragroupe : Une convention de licence (ou de concession de droits) est rédigée entre la société détentrice (concédant) et l’entreprise d’exploitation (licencié). Ce contrat doit définir précisément le périmètre des droits concédés (ex. utilisation d’une marque pour certains produits ou territoires, exploitation d’un brevet dans le processus industriel, etc.), la durée de la licence, son caractère exclusif ou non, et le montant de la redevance.
Il est crucial de soigner la rédaction des clauses de durée, de résiliation et d’exclusivité afin que la licence ne soit pas assimilée à une cession définitive d’actif. En effet, si la licence présente les caractéristiques d’une cession (source régulière de profit, pérennité, cessibilité sans restriction), l’administration pourrait la requalifier en immobilisation, ce qui empêcherait le licencié de déduire les redevances et imposerait celles-ci comme un produit de cession. Il faut donc éviter de cumuler ces trois critères dans le contrat (par exemple, prévoir une durée limitée ou des possibilités de révocation de la licence).
4. Fixation d’un taux de redevance conforme au marché : Le montant des royalties doit être déterminé selon des critères économiques objectifs – typiquement un pourcentage du chiffre d’affaires généré grâce aux actifs concédés, ou un montant forfaitaire annuel – reflétant la valeur apportée par la propriété intellectuelle à l’activité. Il est conseillé de réaliser une étude de prix de transfert ou de faire appel à un spécialiste en valorisation de la PI pour justifier le taux retenu. En pratique, l’administration fiscale tolérerait généralement qu’une filiale verse jusqu’à environ 10 % de son chiffre d’affaires en royalties intragroupe sans sourciller, si l’actif sous licence est déterminant pour son activité. Un taux plus élevé pourrait être admis si justifié par l’importance du brevet ou de la marque, mais il accroît le risque de contrôle.
5. Mise en œuvre comptable et administrative : La société exploitante comptabilise la redevance intragroupe en charge d’exploitation déductiblevillage-justice.com, ce qui vient diminuer son bénéfice imposable. Simultanément, la holding de PI enregistre une production immobilisée ou un produit au titre de la redevance perçue, imposable à l’IS. Il est recommandé de formaliser la politique intragroupe par une convention écrite signée et d’enregistrer éventuellement le contrat de licence auprès des offices compétents (ex. mention de la licence sur le registre national des marques ou brevets, bien que ce ne soit pas obligatoire en France, cela peut renforcer l’opposabilité du contrat). Une documentation de prix de transfert doit être préparée si le groupe dépasse les seuils de chiffre d’affaires requis, justifiant que le niveau de redevance est conforme aux conditions de marché.
Avantages fiscaux et opérationnels
Transfert de bénéfices au sein du groupe : Ce montage permet de remonter des bénéfices depuis l’entreprise d’exploitation vers la société de tête sous forme de royalties. La filiale exploitante réduit d’autant son résultat imposable en France (économisant l’IS à 25 % sur les sommes versées), tandis que la holding encaisse ce revenu. Si la holding est éligible au taux réduit PME de 15 % sur ses premiers 42 500 € de bénéfices, il peut en résulter une économie d’impôt non négligeable en taxant une partie du profit à 15 % au lieu de 25 %.
Protection et valorisation du patrimoine immatériel : Sur le plan opérationnel, regrouper les brevets, marques et autres droits dans une holding les met à l’abri des aléas de l’entité d’exploitation (difficultés financières, procédure collective, etc.). La valeur patrimoniale de la PI est préservée dans la holding, ce qui sécurise les actifs stratégiques. De plus, cela valorise la holding qui encaisse les royalties, améliorant sa capacité financière (les redevances peuvent servir à financer des investissements, des développements R&D ou être redistribuées aux actionnaires via dividendes).
Optimisation de la trésorerie intragroupe : Les flux de royalties peuvent être modulés (dans le respect des justifications de marché) pour ajuster la répartition des profits dans le groupe. Par exemple, en début d’activité, on peut alléger la redevance pour ne pas grever la trésorerie de la filiale exploitante, puis l’augmenter progressivement. Cela offre une flexibilité de gestion fiscale et financière, tant que le montage reste cohérent économiquement.
Gestion centralisée de la propriété intellectuelle : Au-delà de l’aspect fiscal, cette stratégie harmonise la gestion juridique des marques et brevets exploités par différentes entités. La holding peut prendre en charge la surveillance des marques, les dépôts de brevets, les actions en contrefaçon et la défense des droits, mutualisant ces coûts pour le groupe. Les redevances versées rémunèrent justement ces services de gestion et de protection apportés par le concédant de licence.
Risques et précautions à prendre
Requalification en acte anormal de gestion : Si la redevance est inexistante (licence gratuite) ou fixée à un niveau trop faible sans justification, le fisc pourrait y voir un avantage sans contrepartie pour la holding, donc un acte anormal de gestion. Dans ce cas, l’administration taxera a posteriori la société mère sur des royalties « fantômes » qu’elle aurait dû percevoir, tout en refusant la déduction correspondante chez la filiale. Il en résulterait une double imposition préjudiciable au groupe. À l’inverse, si les redevances sont excessives au regard de l’apport réel du brevet ou de la marque dans l’activité, le fisc peut considérer que la filiale a indûment transféré du bénéfice à la holding. Là encore, il procéderait à une réintégration des charges chez le licencié, et possiblement à un rehaussement du résultat taxable de la holding pour bénéfice occulte.
Solution : documenter soigneusement le calcul du taux de royalty (analyses comparables, accords similaires observés sur le marché) et montrer la contrepartie effective apportée par la holding (mise à disposition d’un monopole de droit, services administratifs liés à la PI, etc.).
Non-respect du formalisme du contrat : Une rédaction maladroite du contrat de licence peut conduire à sa requalification en vente d’actif immobilisé. Si l’administration démontre que la licence confère en réalité un usage permanent et cessible du droit de PI (équivalant à une cession), elle pourra exiger que les redevances soient capitalisées et non déduites en charges.
Solution : prévoir une durée limitée (par exemple 5 ans renouvelables) plutôt qu’une licence perpétuelle, éviter les clauses donnant un caractère perpétuel et exclusif irrévocable à la licence, et conserver la possibilité pour la holding de récupérer ses droits (par exemple en cas de changement de contrôle de la filiale licenciée, la licence pourrait être résiliée). L’appui d’un conseil juridique spécialisé est fortement recommandé.
Non-conformité aux prix de transfert : Les opérations intragroupe doivent respecter le principe de pleine concurrence fixé par l’article 57 du CGI. Si l’administration soupçonne un transfert indirect de bénéfices à travers un sur- ou sous-valorisation des redevances, elle peut exiger des justifications économiques et utiliser des comparables de marché. En cas d’écart injustifié, un redressement est possible.
Solution : établir une documentation de prix de transfert solide si le groupe y est assujetti, ou a minima conserver toute analyse ou rapport ayant servi à fixer le taux de licence. En pratique, les autorités fiscales ont la charge de prouver qu’un avantage anormal a été consenti, ce qui souligne l’importance d’être en mesure de démontrer qu’aucun avantage sans contrepartie n’a été accordé dans le montage.
Limites du régime fiscal de faveur : Comme mentionné ci-avant, le taux réduit de 10 % sur les revenus de licence ne s’applique pas aux licences intragroupe en raison de la condition d’indépendance des parties. Par conséquent, la holding sera imposée au taux normal (25 % en 2025) sur les royalties perçues si celles-ci proviennent de filiales.
Précaution : intégrer cette donnée dans les calculs de gain fiscal et ne pas surévaluer l’économie attendue. Néanmoins, une planification ultérieure peut consister à céder la technologie ou la marque à un partenaire externe pour profiter du taux de 10 % à ce moment-là.
Taxe éventuelle sur les conventions intragroupe : Les accords intragroupe comme les conventions de licence doivent être déclarés sur le formulaire dédié (conventions et prestations intragroupe déclarées sur l’imprimé n° 2067) dans le cadre de la liasse fiscale, pour les sociétés relevant de l’intégration fiscale ou dépassant certains seuils. Un manquement à cette déclaration peut entraîner une amende. Il faut donc s’assurer de bien déclarer cet accord dans les obligations déclaratives annuelles de la société.
En résumé, anticiper les risques signifie : valoriser correctement les actifs, justifier les taux de redevance, formaliser un contrat équilibré et respecter le formalisme fiscal. Une telle stratégie, bien encadrée, peut alors s’avérer bénéfique et sécurisée pour une PME innovante.
2. Intégration fiscale horizontale entre sociétés sœurs via une holding commune
Technique
L’intégration fiscale est un régime prévu par le Code général des impôts (articles 223 A et suivants du CGI) qui permet à un groupe de sociétés de consolider leurs résultats fiscaux. Concrètement, une société mère (généralement une holding) totalise les bénéfices et pertes de ses filiales et est seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe. Ce mécanisme autorise notamment l’imputation des déficits d’une entité sur les bénéfices des autres, réduisant le bénéfice imposable global.
Historiquement, l’intégration « verticale » concerne un groupe formé d’une société mère française et de ses filiales détenues à 95 %. Depuis une réforme de 2014, une intégration dite « horizontale » est possible entre sociétés sœurs françaises détenues par une même entité mère établie dans l’UE. Cependant, un particulier (personne physique) ne pouvant constituer à lui seul un groupe fiscal, l’optimisation consiste ici à intercaler une holding entre la personne physique actionnaire et ses sociétés sœurs, afin de créer un groupe intégré fiscalement au niveau national.
Pour que ce montage fonctionne, il faut donc constituer d’une société holding française détenant au moins 95 % des titres de chaque PME sœur, puis opter pour le régime de l’intégration fiscale. La holding devient la tête de groupe fiscal et centralise le paiement de l’IS. Cette stratégie s’appuie sur les dispositions du CGI qui autorisent tout groupe de sociétés à opter pour l’intégration dès lors que : (a) toutes les entités sont soumises à l’impôt sur les sociétés, (b) la société mère détient directement ou indirectement au moins 95 % du capital de chaque filiale, (c) la société mère n’est elle-même pas détenue à plus de 95 % par une autre société soumise à l’IS en France, et (d) toutes ont le même exercice comptable. Dans le cas de sociétés sœurs initialement détenues par une personne physique, la condition de détention à 95 % requiert de restructurer l’actionnariat via la création d’une holding intermédiaire.
Mise en œuvre
1. Création de la holding et apport des titres : L’actionnaire commun des sociétés sœurs crée une société holding (par ex. une SAS) dont il est l’associé unique. Il apporte à cette holding les titres de ses sociétés opérationnelles de manière à ce qu’elle en détienne au moins 95 %. Cet apport en nature peut bénéficier d’un régime de neutralité fiscale (sursis ou report d’imposition de la plus-value d’apport) si les conditions sont respectées. Il est crucial que la holding détienne les participations au 1er jour de l’exercice d’application de l’intégration, afin de pouvoir opter dès le début du prochain exercice.
2. Option pour le régime d’intégration fiscale : La holding doit notifier son option au service des impôts (SIE) dans les délais légaux, c’est-à-dire avant la fin du délai de dépôt de la liasse fiscale de l’exercice précédent celui de l’entrée dans le régime. Concrètement, si l’on vise une intégration à compter de l’exercice N+1, il faut opter avant le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l’année N+1 (pour un exercice calendaire). Le dossier de demande comprendra la liste des sociétés membres du groupe et l’accord écrit de chaque filiale à être intégrée.
3. Convention d’intégration fiscale : Bien qu’elle ne soit pas imposée par la loi, il est fortement recommandé de conclure une convention écrite d’intégration fiscale entre la holding et ses filiales. Cette convention précise les modalités de répartition de la charge d’IS au sein du groupe, les mécanismes de compensation des pertes/bénéfices et éventuellement la manière dont la holding redistribuera aux filiales les économies d’impôt réalisées grâce à l’intégration. En l’absence de convention, la holding supporte par défaut la totalité de l’IS du groupe, mais en pratique on s’accorde souvent pour la refacturer aux filiales bénéficiaires comme si elles étaient imposées séparément, tout en rémunérant la filiale déficitaire pour l’utilisation de son déficit.
4. Gestion fiscale intégrée : Une fois le régime en place, chaque filiale continue à établir sa liasse fiscale individuelle (calcul de son résultat fiscal propre) et la transmet à la holding. La holding procède ensuite au calcul du résultat fiscal consolidé : on additionne les bénéfices et pertes de toutes les sociétés intégrées pour obtenir le résultat d’ensemble sur lequel l’IS sera calculé. La holding dépose une déclaration 2058-UG de résultat d’ensemble et acquitte l’impôt sur les sociétés au nom du groupe. L’intégration est effective pour une durée minimale de 5 ans (tacitement renouvelable par la suite). En cours de vie du groupe, il faut veiller au maintien des conditions (détention 95 %, alignement des dates de clôture). Si une condition cesse d’être remplie (cession partielle de titres entraînant une détention <95 %, changement de date de clôture d’une filiale, etc.), la filiale concernée ou le groupe entier sort automatiquement du régime.
5. Sortie du régime et suivi : À l’issue de la période d’engagement ou en cas de rupture, la sortie de l’intégration doit être déclarée. Certaines conséquences fiscales peuvent survenir lors de la sortie : par exemple, des neutralisations pratiquées pendant l’intégration deviennent caduques. Ainsi, si la holding vend les titres d’une filiale intégrée, la quote-part de 12 % sur les plus-values de cession de titres peut ne plus être neutralisée si la plus-value provient de réserves antérieures à l’intégration. De même, des actes tels que l’abandon de créance consenti en régime intégré deviennent imposables à 12 % si la filiale quitte le groupe dans les 5 ans. Ces mesures anti-abus (parfois nommées amendement Charasse) visent à éviter que le groupe n’ait profité du régime puis sorte avant imposition de certains flux. Il faudra donc anticiper ces effets si une sortie est envisagée.
Avantages fiscaux et opérationnels
Compensation immédiate des pertes et profits : Le bénéfice majeur de l’intégration est la mutualisation des résultats. Les déficits fiscaux d’une filiale viennent réduire les bénéfices imposables des autres, au sein d’une seule base imposable consolidée. Cela permet d’utiliser plus rapidement les pertes (sans attendre un report aux exercices suivants) et de réduire l’IS global du groupe.
Exonération quasi-totale des dividendes intragroupe : En temps normal, lorsqu’une filiale remonte des dividendes à sa société mère, le régime mère-fille permet une exonération d’IS à 95 % (avec taxation d’une quote-part de 5 %). En intégration fiscale, cet inconvénient est quasiment éliminé : les dividendes circulant au sein du groupe intégré sont exonérés à 99 %, seule une quote-part de 1 % restant taxable. Autrement dit, les distributions intragroupe sont pratiquement neutres fiscalement, ce qui est optimal pour faire remonter la trésorerie des filiales vers la holding sans frottement fiscal.
Optimisation des crédits d’impôt et réductions : Le régime intégré permet également de regrouper les crédits d’impôt (CIR, CICE résiduel, crédit apprentissage, etc.) et de les imputer là où c’est le plus efficace. En effet, les crédits d’impôt obtenus par une filiale peuvent s’imputer sur le résultat d’ensemble du groupe. Une filiale déficitaire qui, isolément, n’aurait pas pu utiliser un crédit d’impôt recherche par manque de bénéfice imposable, peut ainsi faire profiter le groupe de cet avantage en le déduisant du bénéfice consolidé. Le surplus de crédits non utilisé par le groupe reste restituable dans les conditions de droit commun.
Paiement unique et simplification de la gestion fiscale : Plutôt que d’avoir x sociétés payant séparément leur impôt, le groupe intégré désigne un seul redevable (la holding) qui acquitte l’IS pour tous. Administrativement, cela facilite le suivi de trésorerie (un seul décaissement d’IS au lieu de plusieurs) et les relations avec l’administration fiscale sont centralisées. Bien que chaque filiale doive toujours établir sa liasse fiscale propre, la procédure de consolidation est désormais rodée et intégrée dans les logiciels de gestion comptable. Pour le dirigeant, la vision fiscale d’ensemble est plus claire : on sait que l’IS sera dû sur le profit global net, ce qui évite par exemple qu’une filiale paie de l’IS alors qu’une autre en perte ne le paye pas – situation parfois mal perçue dans un groupe, car la perte dans une société n’allège pas la facture fiscale d’une autre sans intégration.
Économie potentielle sur la CVAE : Jusqu’en 2023, la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) était calculée, en cas d’intégration fiscale, sur la somme des chiffres d’affaires du groupe. Cela pouvait être un inconvénient si chaque société individuellement était en dessous du seuil d’assujettissement (500 000 € de CA par entité par exemple) mais que le total consolidé dépassait ce seuil. Cependant, la CVAE étant supprimée à compter de 2024, cette considération devient caduque. Au contraire, l’intégration pourrait même simplifier les éventuelles déclarations de CET (Cotisation Économique Territoriale) futures si un mécanisme global venait à la remplacer.
Renforcement de la cohésion de groupe : Sur un plan plus stratégique, le fait de créer une holding et d’opter pour l’intégration fiscale traduit une structuration plus forte du groupe. Cela peut faciliter des projets communs entre les filiales (puisque le succès de l’une profite fiscalement aux autres), inciter à des mutualisations de coûts, et donner une image financière consolidée du groupe vis-à-vis des banques ou partenaires (même si l’intégration fiscale ne dispense pas d’établir des comptes consolidés en normes comptables si les seuils l’exigent). Cette cohésion fiscale accompagne souvent des synergies opérationnelles accrues.
Risques ou inconvénients à anticiper
Perte du bénéfice des taux réduits d’IS pour chaque filiale : En France, les PME bénéficient d’un taux réduit de 15 % sur une première tranche de résultat (42 500 € en 2025) si leur chiffre d’affaires est inférieur à 10 M€. Dans un groupe intégré, seule la société mère profite de ce taux réduit sur la tranche de 42 500 € du résultat d’ensemble. Ainsi, si plusieurs filiales généraient chacune des petits bénéfices éligibles au 15 %, le fait de consolider peut priver le groupe de l’application multiple de ces taux réduits.
Formalités et gestion comptable plus complexes : Mettre en place et suivre une intégration fiscale exige une certaine technicité fiscale et comptable. Il faudra produire chaque année une liasse fiscale consolidée, suivre les éliminations intragroupes et les éventuels retraitements (par exemple, neutralisation des provisions latentes entre entités, retraitement des dividendes intra-groupe dans le calcul du résultat d’ensemble, etc.). Les déclarations comptables au niveau de la holding sont plus lourdes. Il peut être nécessaire de recourir à un expert-comptable ou à un fiscaliste pour assurer la conformité du processus, surtout les premières années. Ce surcroît de complexité administrative a un coût qu’il faut comparer aux économies attendues.
Engagement de stabilité sur 5 ans : L’option d’intégration fiscale est verrouillée pour une durée de 5 exercices minimum. Si le groupe sort volontairement du régime avant ce délai, il s’expose à des conséquences rétroactives (remise en cause de certaines neutralisations, rattrapage de quote-part sur dividendes distribués, etc.). En cas de cession d’une filiale ou d’ouverture du capital à un investisseur qui ferait tomber la participation de la holding sous 95 %, le groupe serait dissous et là encore certaines mesures anti-abus pourraient s’appliquer. Par exemple, les dividendes mis en réserve avant l’intégration, puis distribués pendant l’intégration, sont neutralisés ; mais si la filiale sort du groupe, ces distributions passées redeviennent imposables à une quote-part de 12 %. Il est donc important de planifier sur le long terme et de s’assurer que l’on pourra respecter l’horizon de 5 ans. Une restructuration prématurée peut annihiler les bénéfices du régime et générer des régularisations compliquées.
Risques liés aux opérations internes : Bien que l’intégration fiscale offre des avantages, certaines opérations intragroupe restent surveillées. Par exemple, si la holding a contracté un emprunt pour acheter les titres des filiales (montage d’acquisition avec effet de levier), la déduction des intérêts peut être limitée par la règle dite Charasse lorsqu’il y a rachat de sociétés liées. De même, en régime intégré, les transferts d’actifs entre sociétés du groupe ne sont pas automatiquement neutralisés (sauf régime spécifique d’apport-fusion) et peuvent faire l’objet de taxation immédiate en cas de plus-value, sauf engagement de conservation 5 ans. Il faut donc gérer prudemment les opérations intragroupe structurantes (cessions d’actifs, refacturations importantes, etc.) pour ne pas déclencher d’imposition non anticipée.
En synthèse, l’intégration fiscale via une holding offre un véritable levier de planification fiscale pour un groupe familial de PME. Cependant, son intérêt net dépend du profil des résultats des entités (cas de déficits à absorber en priorité) et nécessite un suivi attentif. Un dirigeant de PME industrielle tirera parti de cette technique en se faisant accompagner pour la mettre en place correctement (notaire ou avocat pour créer la holding et faire les apports, expert-comptable pour la consolidation fiscale) et ainsi sécuriser les économies d’impôt attendues.
3. Portage international de R&D via contrat de prestation entre sociétés liées
Technique
Le portage international de R&D consiste à tirer parti des différences de fiscalité entre pays en organisant les activités de recherche-développement (R&D) du groupe au moyen de prestations intragroupe transfrontalières. Le principe général est qu’une entité située dans un pays à fiscalité douce (impôt sur les sociétés réduit) réalise ou finance des travaux de R&D pour le compte d’une entité française, de sorte qu’une partie du profit lié à l’innovation soit taxée dans le pays à faible imposition. Deux schémas principaux peuvent être envisagés :
Schéma A (sous-traitance sortante) : La société française confie une partie de ses projets R&D à une filiale ou société sœur établie dans un pays à fiscalité avantageuse, via un contrat de prestation de services R&D. La société française paye à l’entité étrangère des factures de R&D (généralement en cost-plus, c’est-à-dire remboursement des coûts majorés d’une marge). Ces charges sont déductibles du résultat en France, ce qui diminue l’IS dû en France, tandis que la filiale étrangère enregistre un bénéfice (la marge) faiblement taxé localement.
Schéma B (sous-traitance entrante) : Inversement, la filiale étrangère (par exemple une holding internationale du groupe) finance les activités de R&D menées en France, en mandatant la société française comme sous-traitante. La société française, rémunérée en cost-plus, ne conserve qu’une faible marge taxable en France, et transfère la propriété des résultats (brevets, prototypes, savoir-faire) à l’étranger. Ainsi, l’essentiel de la valeur créée (l’actif incorporel issu de la R&D) appartient à l’entité du pays à fiscalité douce, qui pourra ensuite le commercialiser ou le licencier en bénéficiant de son régime fiscal privilégié. Ce second schéma correspond à une externalisation des actifs IP : la filiale française devient un centre de R&D prestataire pour sa maison-mère étrangère.
Dans la pratique des groupes internationaux, le schéma B est fréquent – on parle de Contract R&D ou de cost sharing agreement. Il permet de localiser les droits de propriété industrielle (brevets, logiciels, etc.) et les profits futurs dans un pays à faible imposition, tout en profitant des compétences techniques présentes en France. Juridiquement, ces montages sont encadrés par le droit des contrats (contrat de prestation de services de R&D) et le droit fiscal international (règles de prix de transfert, conventions fiscales bilatérales, et dispositifs anti-abus tels que les règles CFC – Controlled Foreign Corporation – de l’article 209 B du CGI). Le contrat doit notamment préciser la nature des travaux de recherche confiés, les modalités de calcul de la rémunération, et la propriété des résultats (titularité des brevets, licences, etc.).
Le fondement fiscal repose sur le principe que chaque société d’un groupe, y compris à l’international, peut librement établir des contrats de prestation intragroupe tant qu’ils respectent les conditions du marché. La convention fiscale entre la France et le pays en question évitera la double imposition, et la directive européenne sur les paiements d’intérêts et redevances ou la législation interne détermineront s’il y a des retenues à la source. Dans le cas d’une prestation de services pur (et non d’une redevance de licence), la plupart des conventions fiscales attribuent le droit d’imposer au pays du bénéficiaire effectif des profits (ici, le pays du prestataire étranger) et n’instaurent pas de retenue à la source en France sur les services rendus. Ainsi, un contrat de sous-traitance R&D intragroupe bien structuré peut permettre de déduire en France des dépenses significatives, sans qu’aucun impôt à la source ne soit prélevé sur les paiements vers l’étranger, et avec une imposition réduite des bénéfices chez le prestataire étranger.
Mise en œuvre
1. Choix de la juridiction « à fiscalité douce » : Il s’agit de sélectionner le pays où sera localisée l’entité qui participera au montage. Les critères incluent : un taux d’IS bas (par ex. 0 à 15 %), une convention fiscale avec la France pour éviter les doubles impositions, une stabilité juridique, et la possibilité d’y réaliser de la R&D réelle (présence de personnels qualifiés, etc.). Des exemples classiques incluent : l’Irlande, les Pays-Bas, Chypre, Malte, ou encore des pays hors UE comme la Suisse, Singapour, voire des juridictions sans IS (Dubaï, Bahamas) – bien que ces dernières posent d’autres problèmes (cf. substance et CFC).
2. Création ou utilisation d’une société liée dans ce pays : Concrètement, le groupe peut soit créer une nouvelle filiale R&D dans le pays choisi, soit utiliser une entité existante (par ex. une holding internationale) en lui affectant l’activité R&D. Cette société doit avoir une substance économique réelle dans son pays : idéalement des locaux, du personnel (ingénieurs, chercheurs) ou au moins la capacité de sous-traiter localement une partie des travaux. En effet, la crédibilité fiscale de l’opération repose sur l’existence d’une activité effective à l’étranger, sans quoi le fisc français pourrait arguer que l’entité étrangère est purement artificielle.
3. Élaboration du contrat de prestation de R&D : Une convention intragroupe est rédigée entre la société française et la société étrangère. Si on suit le schéma A (la France paie l’étranger), le contrat stipule que la filiale étrangère effectuera des travaux de R&D définis (développement de prototypes, réalisation de tests, études de conception…) pour le compte de la société française, en échange d’une rémunération en coût complet majoré d’une marge (par ex. coût + 8 %).
Si on suit le schéma B (la France est prestataire pour l’étranger), le contrat – souvent appelé General Services Agreement – prévoit que la société française cède à la société étrangère tous les résultats et droits découlant de ses activités de recherche, moyennant le remboursement de ses coûts plus une marge convenue. Dans les deux cas, il faut déterminer la base de coûts (typiquement les salaires des chercheurs, dotations aux amortissements des labos, consommables, etc.) et le % de marge approprié. Une étude de comparables de marché (sociétés de R&D indépendantes, taux de marge sectoriels) peut être utile pour justifier que, par ex., une marge de 5–10 % est dans la norme. Le contrat doit aussi fixer les modalités pratiques : reporting des travaux, propriété intellectuelle, confidentialité, etc.
4. Mise en place opérationnelle de la R&D : Il ne suffit pas d’un contrat, il faut le réaliser effectivement. Si la société étrangère est censée effectuer la R&D (schéma A), elle doit soit employer du personnel R&D, soit sous-traiter localement. Par exemple, une filiale en Irlande peut recruter quelques ingénieurs locaux ou expatriés, ou collaborer avec un centre technologique irlandais, pour mener des recherches facturées à la France. Dans le schéma B, la filiale française mène les recherches comme d’habitude, mais en sachant que les résultats appartiennent à l’étranger. Dans les deux cas, on veillera à bien documenter les travaux (rapports scientifiques, délivrables, brevets déposés) pour pouvoir démontrer la réalité de la prestation transfrontalière. Sur le plan fiscal, la société française inscrira les factures reçues (schéma A) en charges externalisées de R&D, ou facturera (schéma B) à la société étrangère en produits d’exploitation.
5. Gestion des flux financiers et fiscaux : La société française paiera périodiquement (mensuellement, trimestriellement) les factures à la société étrangère, ou inversement recevra les paiements convenus. Il faudra respecter les obligations locales (par ex. facturation avec ou sans TVA selon les règles de TVA intra-UE ou extraterritoriales pour les services). Fiscalement, la société étrangère déclare ses revenus de prestation et paie l’IS local (faible), tandis que la société française déduit ses charges ou déclare seulement sa faible marge. Il est crucial de s’assurer qu’aucune retenue à la source ne s’applique sur ces flux : dans la plupart des cas de prestation de services, la France n’en prévoit pas, mais il faut vérifier que le pays de destination ne requalifie pas le paiement en redevance ou autre. Avec l’Union européenne, la libre prestation de services et les conventions bilatérales font qu’habituellement il n’y a pas de retenue, surtout si le contrat n’implique pas le transfert de droits d’auteur ou brevets (sinon, on tomberait dans le régime des redevances). En cas de doute, une clause du contrat peut préciser la nature des paiements (honoraires de services techniques) afin d'éviter toute ambiguïté.
Avantages fiscaux et opérationnels
Réduction globale de l’impôt sur les sociétés : Le principal intérêt est de faire en sorte qu’une partie du profit lié à l’innovation soit taxée à un taux inférieur à celui de la France (25 %). Dans le schéma A, la France diminue son bénéfice imposable en payant des services à l’étranger, économisant 25 % sur chaque euro ainsi déduit, tandis que l’étranger ne paie que, par exemple, 12,5 % ou moins. Dans le schéma B, la France elle-même ne dégage qu’une faible marge (taxée à 25 %), tout le reste du profit (valeur de l’actif créé) se concrétisera via la filiale étrangère (soit par redevances futures, soit par plus-value si elle vend la technologie) et sera imposé à taux réduit. Ainsi, le groupe délocalise la base imposable de l’innovation vers un environnement fiscal allégé.
Bénéfice des régimes incitatifs étrangers : De nombreux pays offrent des incitations fiscales spécifiques à la R&D ou à la propriété intellectuelle. En logeant la R&D ou l’IP dans ces pays, l’entreprise peut bénéficier de super-déductions ou de crédits d’impôt locaux. Par exemple, l’Espagne permet une déduction de 42 % des dépenses de R&D excédant la moyenne des années précédentes, la Belgique a une déduction pour revenus d’innovation de 85 %, etc. Si le montage est bien fait, la filiale étrangère peut cumuler ces avantages avec son faible taux d’IS. Comparativement, en France le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) est généreux (30 % des dépenses) mais limité aux dépenses éligibles effectuées en France. En sous-traitant à l’étranger, on peut parfois cumuler le CIR français et l’avantage étranger : par exemple, une entreprise française peut obtenir le CIR sur une partie de ses dépenses internes, et sa filiale étrangère avoir un IP box sur les revenus. (Attention toutefois : si la dépense de R&D est entièrement facturée par une filiale liée, l’administration française pourrait considérer que ce n’est pas une sous-traitance éligible au CIR, surtout si filiale hors UE. Le cas échéant, mieux vaut que le CIR soit demandé par l’entité qui effectue réellement la R&D.)
Flexibilité financière et optimisation des coûts : Confier la R&D à une entité dans un pays à coûts salariaux moindres peut également réduire le coût même de la R&D. Par exemple, installer un centre de développement en Europe de l’Est ou en Asie permet de profiter de chercheurs talentueux à rémunération inférieure, ce qui diminue la base de facturation intragroupe. La société française paiera moins cher la prestation qu’elle ne l’aurait dépensée en interne, améliorant sa rentabilité. Par ailleurs, le montage contractuel permet d’ajuster le niveau de facturation : la marge appliquée peut être calibrée pour transférer plus ou moins de profit selon la stratégie (tout en restant dans les limites du raisonnable pour les prix de transfert). Cette flexibilité peut aider, par exemple, à soutenir une filiale étrangère en phase de croissance (en lui allouant une marge plus confortable) ou au contraire à rapatrier du profit en France si besoin (en baissant la marge étrangère – mais attention à ne pas faire n’importe quoi, l’objectif restant l’optimisation légale).
Constitution d’actifs à l’étranger et protection : En externalisant la propriété des résultats de R&D dans un autre pays, le groupe peut diversifier son risque juridique et politique. Si le pays en question offre une meilleure protection des brevets ou un environnement plus stable sur certains plans, l’actif incorporel y est en sécurité. De plus, cela facilite éventuellement une expansion internationale : la filiale étrangère détentrice de la technologie peut concéder des licences dans le monde entier, elle est située dans un hub international ce qui peut rassurer des partenaires locaux. Pour l’entreprise française, c’est une manière de s’internationaliser sur le plan des actifs, ce qui peut être un atout en cas de recherche d’investisseurs étrangers (ceux-ci apprécient souvent que l’IP soit logée dans un pays neutre fiscalement).
Optimisation globale de la chaîne de valeur : Le portage international de R&D s’inscrit souvent dans une stratégie plus large d’optimisation, couplant prix de transfert et localisation des fonctions. Par exemple, une PME industrielle qui vend à l’étranger pourrait installer sa fonction commerciale (distribution) dans un pays à fiscalité faible, sa fonction achats/logistique ailleurs, etc., et fixer les prix de transfert de manière à accumuler le plus de profit possible dans la filiale faiblement taxée. La prestation de R&D s’intègre dans cette logique en rémunérant la R&D au juste niveau tout en permettant au profit résiduel (lié aux intangibles) de se retrouver là où le taux est bas. C’est ainsi que les grands groupes techno répartissent leurs profits : royalties vers l’Irlande ou les Pays-Bas, facturation de services intra-groupes depuis la Suisse, etc. À l’échelle d’une PME, on peut en proportion moindre appliquer ces recettes pour diminuer le taux effectif d’imposition du groupe de quelques points.
Risques et précautions à prendre
Contrôle des prix de transfert (article 57 du CGI) : Le fisc français sera attentif à ce que la rémunération versée à la filiale étrangère corresponde à une véritable prestation justifiée. S’il estime que la filiale étrangère a reçu un avantage excessif (par exemple une marge trop élevée par rapport à sa contribution réelle), il pourra utiliser l’article 57 du CGI pour requalifier l’opération en transfert indirect de bénéfices. Il lui faudra alors démontrer soit qu’aucune contrepartie équivalente n’a été reçue par la société française (avantage sans compensation), soit qu’il y a un écart manifeste avec la valeur de marché de la prestation.
En cas de redressement, l’administration réintégrera dans le bénéfice imposable en France la quote-part jugée excessive et pourra appliquer des pénalités.
Parade : documenter l’étude de prix de transfert, par exemple en montrant que d’autres sociétés de R&D indépendantes facturent leurs services avec une marge comparable.Application des règles anti-abus (CFC et BEPS) : L’article 209 B du CGI (règle CFC) permet à la France d’imposer les profits d’une entité contrôlée à l’étranger si celle-ci est soumise à une fiscalité inférieure à la moitié de la fiscalité française et n’a pas d’activité économique réelle. Autrement dit, si vous créez une filiale dans un paradis fiscal purement pour y loger du profit passivement, le fisc pourra tout de même vous taxer en France sur ces bénéfices.
Précaution : s’assurer que la filiale étrangère a une substance suffisante (locaux, personnel qualifié, dépenses locales) et qu’elle exerce une activité effective de R&D ou de gestion de PI. Si la filiale a une activité industrielle et commerciale réelle dans son pays, l’exception pour activités substantielles peut la soustraire à 209 B. On évitera donc le piège d’une boîte vide aux Bermudes sans employés. Par ailleurs, les recommandations BEPS (érosion de la base imposable) de l’OCDE ont conduit de nombreux pays à instaurer des conditions de nexus pour les régimes IP – par exemple, ne bénéficier du taux réduit sur brevets que si la R&D correspondante a été effectuée localement. Il faut vérifier ces conditions : si la filiale étrangère veut un patent box local, peut-elle inclure de la R&D faite en France ? Souvent non, à moins d’un accord de cost-sharing où la filiale finance la R&D. D’où l’importance du montage contractuel bien fait.Perte (ou complexité) du bénéfice du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) : Le CIR français est un avantage important (30 % des dépenses de R&D éligibles). Or, si une société française sous-traite de la R&D à une entreprise liée, ces dépenses ne sont pas éligibles au CIR (les prestations intragroupe ne donnent pas droit au CIR, sauf éventuellement via un organisme de recherche agréé, ce qui n’est pas le cas d’une filiale classique). Ainsi, dans le schéma A, les 300 k€ payés à la filiale étrangère ne pourront pas être inclus dans l’assiette du CIR d’Alpha. Cela peut réduire l’intérêt du montage si le CIR perdu est supérieur à l’impôt économisé. Dans le schéma B, la filiale française pourrait continuer de toucher le CIR sur ses dépenses, mais attention : en général, si les dépenses sont remboursées par une tierce partie (ici la maison-mère étrangère), on considère que la filiale française n’en supporte pas réellement le coût économique et pourrait devoir déduire ces subventions/CIR de sa base de facturation.
Conclusion : il faut calculer si l’optimisation internationale compense la perte partielle ou totale du CIR. Parfois, on peut opter pour un compromis : garder en France les travaux très éligibles au CIR (pour engranger le crédit) et externaliser d’autres travaux moins "cirables".Risques de requalification en établissement stable : Si la filiale étrangère intervient de manière trop intense en France (personnel présent, direction effective des opérations en France, etc.), il y a un risque que l’administration étrangère ou française considère qu’elle a un établissement stable en France et donc devrait y être imposée. Par exemple, si une société maltaise est censée faire la R&D mais que tous les chercheurs travaillent depuis la France sous la direction du siège français, on peut arguer que l’activité est en réalité exercée en France.
Solution : respecter une séparation nette des rôles, éventuellement détacher physiquement certains employés à l’étranger (ou embaucher localement), et éviter que la filiale étrangère n’ait une présence permanente en France (bureaux, agent dépendant, etc.). A contrario, veiller aussi à ce que la filiale étrangère ne soit pas gérée de France au point d’être considérée comme fiscalement résidente en France (critère de direction effective).Complexité juridique et coûts de mise en place : Monter une structure à l’étranger engendre des frais de création et de fonctionnement (constitution de société, honoraires juridiques, comptables locaux, gestion multi-pays). Pour une PME, cela n’est rentable que si les gains fiscaux attendus sont significatifs et pérennes. De plus, il faut administrer le contrat de prestation : assurer les facturations régulières, suivre les changes si devises différentes, gérer la comptabilité de la filiale étrangère, etc. Ces charges administratives supplémentaires peuvent mobiliser du temps de management. Il faut donc un minimum de taille critique de projet pour justifier l’opération (par exemple, des dépenses de R&D annuelles de plusieurs centaines de milliers d’euros ou plus). Par ailleurs, en cas de contrôle fiscal international, il faudra être prêt à justifier l’ensemble du montage devant éventuellement deux administrations (France et pays étranger), ce qui peut impliquer de mobiliser des fiscalistes et avocats dans les deux pays. C’est un élément à considérer dans l’arbitrage gain/coût.
En somme, le portage international de R&D est un levier puissant d’optimisation fiscale internationale, potentiellement adapté à des PME déjà tournées vers l’export ou l’international. Il requiert une approche prudente, en veillant à ce que la réalité économique du montage soit défendable (substance, prix de transfert corrects) pour ne pas tomber sous le coup de l’abus de droit. Lorsqu’il est mis en œuvre dans les règles, ce dispositif peut aboutir à un taux effectif d’imposition du groupe bien inférieur au taux normal français, tout en maintenant l’innovation et les emplois en France (si c’est le choix) ou en bénéficiant d’écosystèmes R&D étrangers dynamiques.
Conclusion
Ces trois techniques – accord de propriété industrielle avec redevances internes, intégration fiscale via holding, et portage international de la R&D – illustrent la palette d’outils à la disposition des PME industrielles françaises pour optimiser leur fiscalité de manière légale et stratégique. Chacune adresse une problématique spécifique : la première protège et monétise les actifs immatériels tout en modulant le résultat fiscal, la deuxième permet une gestion unifiée de l’impôt au sein d’un groupe national, et la troisième tire parti de la concurrence fiscale internationale pour réduire le taux effectif d’imposition sur les profits d’innovation.
Si ces techniques peuvent être de véritables atouts dans votre développement, elles nécessitent tout de même une mise en oeuvre cadrée, accompagnée d'experts qualifiés.
Pour prendre rendez-vous et discuter des possibilités d'optimisation fiscale de votre entreprise, prenez rendez-vous via le formulaire de contact.
Chapman & Chapman SAS
Stratégie et juridique pour vos projets d'affaires.
© 2025. All rights reserved.
SIRET 94269043900016